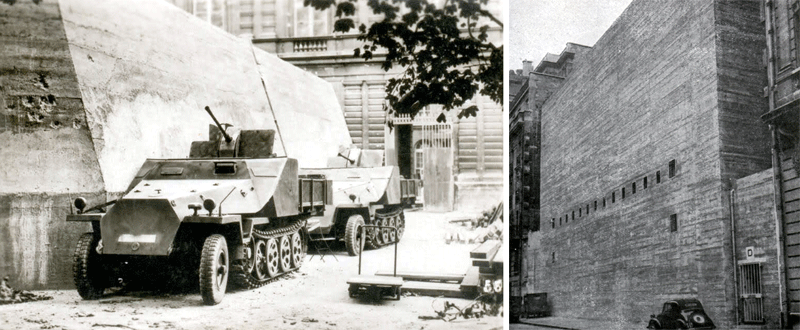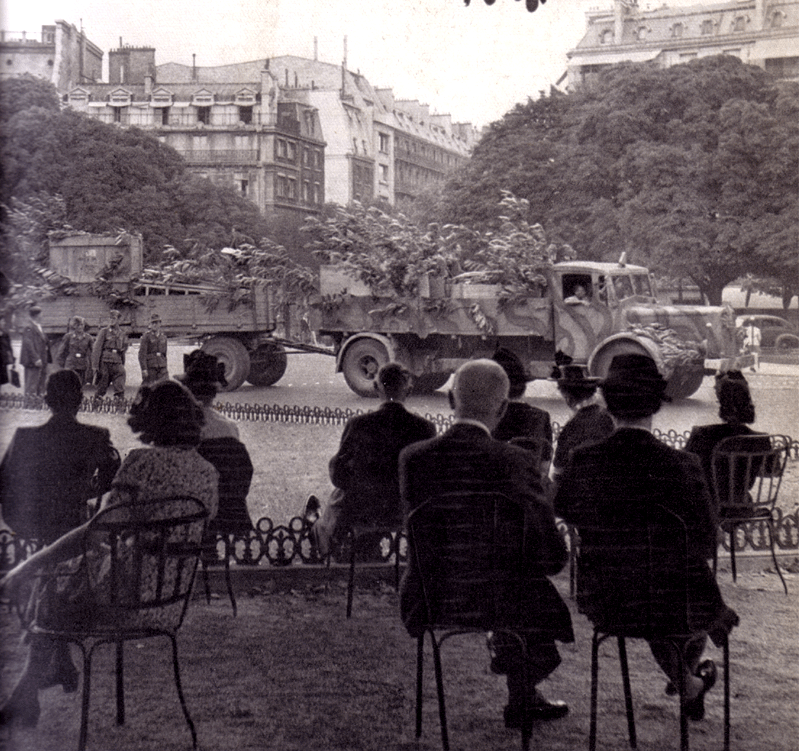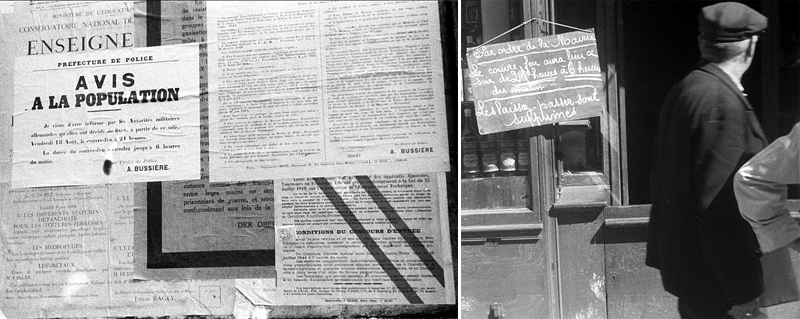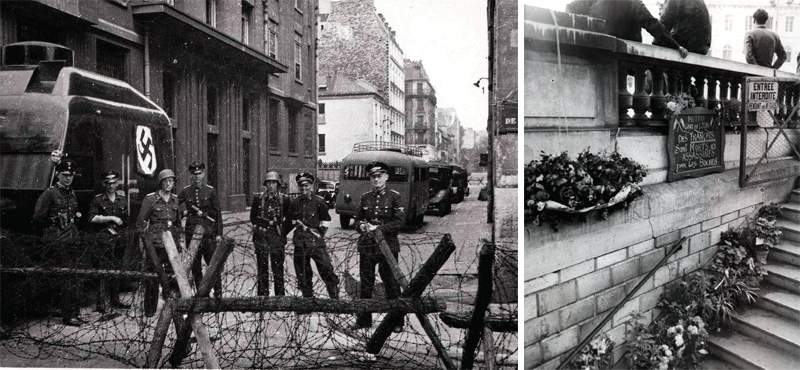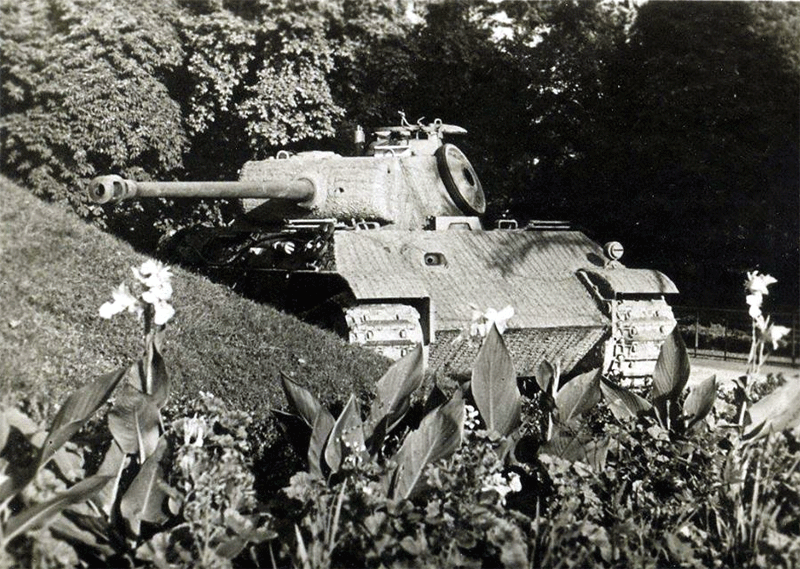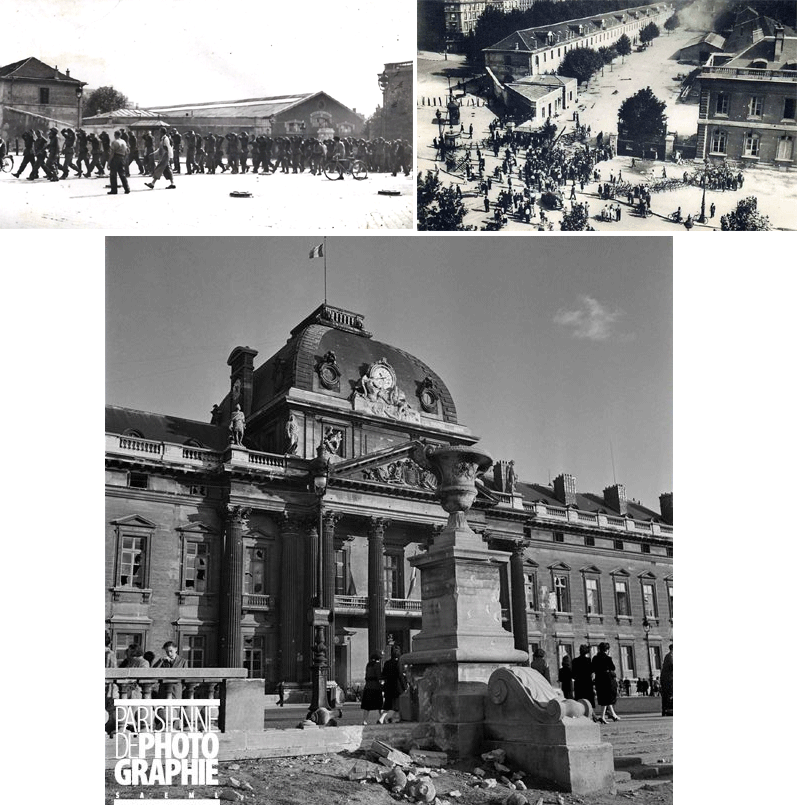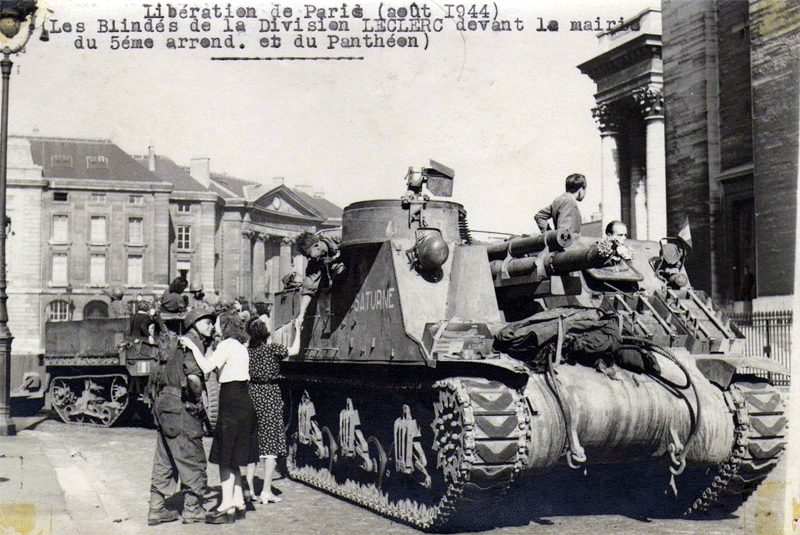Médecin spécialiste, le docteur Charles Jacquelin était installé 15, Place du Panthéon au 1er étage. Il y habitait avec son épouse Jacqueline née en 1900 et ses deux filles Denise, à l’époque quatorze ans, et Marie-Claire, treize ans. Né en 1888, Charles avait alors cinquante-six ans. Après son service militaire (deux ans) il avait fait la guerre de 14-18 sur le front. Blessé en octobre 1917 il était retourné dès que possible au front. Il restait “une gueule cassée”. En 1939 il est à nouveau mobilisé. Responsable d’un service d’hospitalisation à Amiens, il y organise et prend la direction de l’évacuation de ses malades, du personnel médical et administratif, au moment du bombardement allemand sur Amiens en mai ou juin 1940, évitant à ceux qui ont pu et voulu partir avec son convoi, d’être tués ou prisonniers. Charles connaissait la guerre, les armées, les militaires, les armes, et les humains… Humaniste, cultivé, il était juste, modéré. Il avait acquis une sérénité relative. Sa famille, ses amis, ses patients et les choses de l’esprit, littérature et arts comptaient infiniment pour lui.
Docteur Claire J.
La Chronique journalière de Ch. Jacquelin
10-12 août 1944
Depuis quelques jours l’avance des alliés allume la fièvre de Paris. Les bruits courent, invérifiables. On les dit à Chartres, à Rambouillet, à Versailles. Les journaux pourtant situent le front à l’ouest de Chartres. Les coups de téléphone privés assurent que Versailles n’a vu encore aucun blindé américain. Pour Chartres il semble bien que les motorisés aient poussé une pointe jusque là, quelques motocyclettes, mais ils ont été refoulés ou tués. Tout le monde commence à parler de la « bataille de Paris ». Il y a quinze jours ou même plus, le bruit a couru d’une convention germano-alliée qui reconnaîtrait Paris « Ville Sanitaire ». Cette convention aurait été engagée sur l’initiative de l’ambassade de Suède. Déjà dans certains hôpitaux les chefs de service donnaient des conférences sur les blessures de guerre. Mais cette convention a été démentie.
A l’intérieur des Jardins du Luxembourg et à l’hôtel Majestic
Les Allemands ont renforcé leurs défenses dans Paris même. Ils sont en train de construire en dehors du jardin du Luxembourg, et en plus des blockhaus au ras des trottoirs, des espèces de petits fortins, l’un devant le bassin du Luxembourg, un autre devant la porte du Sénat, un autre qui barre complètement la rue de Vaugirard au coin de la rue Guynemer. Encadrement bois à double cloison, à l’intérieur desquelles doit être coulé du ciment. On me rapporte que dans celui de la rue de Vaugirard ils ont installé un tank. Tout cela ne cadre pas avec « Paris Ville Sanitaire ». Un client me dit que sa femme qui habite Montmartre a vu des milliers de travailleurs creuser des tranchées.
Dimanche 13 août
Une amie des enfants, fille d’un gardien de la paix, leur certifie que les agents ont reçu hier soir, par les soins de l’Armée secrète, des brassards à Croix de Lorraine, et que demain…
Lundi 14 août
Le lendemain matin les agents sont à leur poste. A midi quand je reviens de la rue de la Chaise (1), au coin de la rue de Seine et de la rue Saint-Sulpice, l’agent habituel qui garde le passage allemand vers le Sénat est à son poste. Vers midi et demie les agents du poste de la mairie du V° (2) s’en vont comme à l’habitude, mais TOUS. Le poste est déserté et fermé à clef. Une heure plus tard des miliciens montent la garde devant le poste. Ils ont armes et mitraillettes. Un peu plus tard des allemands se mêlent à eux. Les agents sont en grève.
(1) Charles allait voir des malades à la clinique de la rue de la Chaise. (2) Visible des fenêtres de notre appartement, un poste de police à l’angle de la rue Soufflot
Ce sont les soldats allemands qui se chargeront de régler la circulation
Mardi 15 août
En consultation avec Ogliastri (1). Il m’assure qu’il y a eu hier à l’Hôtel de Ville une réunion importante à laquelle auraient assisté Laval, Herriot qu’on serait allé chercher dans une maison de santé, Jeanneney, et d’autre part un représentant de la garnison allemande de Paris et peut être un officier de l’armée américaine. On aurait cherché un accord pour éviter à Paris la bataille et on aurait formé une sorte de gouvernement provisoire de Paris qui assurerait l’ordre entre le départ des allemands et l’arrivée des américains. L’après-midi je vais porter un dossier chez Magnan (2) et il me confirme qu’il y a eu tractation à l’Hôtel de Ville dans des conditions voisines de celles que m’a rapportées Ogliastri. Il me dit cependant qu’elle a échoué; que les Américains exigeaient une évacuation à plus de 30 kms à l’est de Paris et que les Allemands ont refusé et qu’on reste donc indécis sur le sort de Paris.

Pierre Laval, chef du Gouvernement, Edouard Herriot, ex-président de la Chambre des députés et Jules Jeanneney, ex-président du Sénat.
En sortant avec Jacqueline nous passons devant l’Hôtel de Ville qui n’est plus gardé par les agents mais par des Gardes Républicains, puis devant la Préfecture de Police pareillement occupée par les Gardes. Mais devant la porte principale de nombreux groupes d’agents habillés entièrement en civil; on en voit entrer et sortir par la porte de la Préfecture. Tout paraît plus calme que nous n’avions craint. Nous avions bien recommandé aux enfants de ne pas descendre dans la rue et c’est avec une petite appréhension qu’ils nous avaient vus moi et leur mère quitter la maison. Les cafés sont ouverts et nous avons pris tranquillement un bock au coin de la rue de Rivoli et de la place de l’Hôtel de Ville. Tout va peut être s’arranger.
(1) Confrère et ami de Charles qui habitait vers la place des Vosges. (2) Autre confrère.
Mercredi 16 août
La grève des agents continue. Le bruit court – et ceux qui sont en civil autour des postes disent – qu’ils ne reprendront leur uniforme qu’au moment où les Américains entreront dans Paris. Sur l’avance des Américains, aucune nouvelle. Les journaux ont cessé aujourd’hui de paraître et ne reparaîtront plus. Cette disparition apparaît comme le premier témoignage que les Allemands abandonnent Paris à son prochain sort. Mais où sont les blindés alliés ? Chartres est sûrement pris. Mantes et Vernon aussi. Mais plus loin rien n’est précis – il est toujours question de Versailles. Quelqu’un m’assure même que les Américains stoppent volontairement devant Versailles – et qu’on en a vu jouer au football aux portes de la ville. Quelqu’un d’autre m’assure qu’aucun Américain n’est encore apparu à Versailles. On parle aussi de Rambouillet, de Montfort-l’Amaury. C’est la nuit ou plutôt non : sans qu’on distingue les choses, on sent venir la lumière, on sent que le jour est tout près, on cherche de quel coté l’aube va apparaître. Tout se passe ce jour-là comme les autres jours : je reçois des clients qui ont pu venir à pied. Mais c’est sûrement un des derniers jours comme ceux là. Peut-être demain, peut-être après demain, tout va être changé.
Correction en marge de Charles Jacquelin : Non, c’est inexact. Les journaux ont paru encore ce mercredi. C’est le jeudi qu’ils ont disparu ; mais leur disparition m’a été annoncée le mercredi par la petite mercière de la rue Clotaire.
Jeudi 17 août
Pendant que je suis au tennis aux Buttes-Chaumont, vers les 17 heures, Lagarenne arrive : c’est officiel, une convention vient d’être établie à l’Hôtel de Ville entre les Allemands, Laval, Jeanneney, Herriot et un général américain. Convention valable pour Paris. Les Allemands s’engagent à ne pas défendre Paris. Ils se retireront aujourd’hui à 30 km de la capitale. Leur repli ne sera pas inquiété. Dès demain une commission en partie américaine sera à Paris pour les dernières décisions. Paris sera « Ville Sanitaire ». Les Allemands laissent quelques milliers de leurs grands blessés et ont tenu à les confier à la Croix-Rouge Française. Tout le monde respire, tant de bruits inquiétants avaient couru : non seulement sur les fortifications faites par les Allemands à l’intérieur de Paris mais sur celles qu’ils venaient encore de renforcer hâtivement autour de Paris en particulier dans la région de Montmorency. Qu’ils s’en aillent donc, qu’on les laisse rapidement s’en aller. Lagarenne rapporte aussi l’annonce officielle d’un débarquement allié en Belgique. C'est la prise à revers des armées allemandes et dislocations de leurs défenses; la déroute prochaine.
Des membres de l’Organisation Todt aident au déménagement (photographie Musée Carnavalet)
En rentrant à la maison j’annonce la bonne nouvelle. Ces jours derniers d’ailleurs, indépendamment des bruits qui couraient depuis mardi sur les tractations de l’Hôtel de Ville, on avait vu se vider beaucoup de maisons ou d’établissements occupés par les Allemands. Des camions emportaient assez pêle-mêle et comme hâtivement des armes, des munitions, des archives, des matelas, des caisses, des tonneaux, des paquets de ravitaillement. Mais ce soir doit être le grand départ. Après dîner nous voulons assister, nous voulons sentir dans la rue et de près ce témoignage de la proche défaite allemande. Le père, la mère, les deux filles, nous voici sur le Saint-Michel ; la foule ou du moins un nombre assez considérable de curieux est massée sur les trottoirs en particulier devant Capoulade (1), en face de la Soldatenheim (2) et plus loin devant chez Picard, La Source (3), Trianon. La rue de Vaugirard est gardée par deux jeunes SS. Quand nous passons je vois distinctement leur doigt sur la gâchette de leur mitrailleuse. Un mouvement, un cri, une moquerie de la foule en face et tout peut se gâter d’un moment à l’autre. Par la rue de l’École-de-Médecine nous gagnons le Sénat : même foule de curieux sur les trottoirs. Des tanks prêts au départ, des camions qu’on finit de charger, des soldats qui cherchent leur place. La foule est silencieuse, mais non sans ironie dans les regards. Ce départ en hâte sous les yeux d’une foule qu’elle sent satisfaite et moqueuse, quelle humiliation, quelle vexation pour cette armée si orgueilleuse, qui n’a pas encore connu la défaite.
Ballet de camions sur les Champs-Elysées
Comment n’ont-ils pas mieux organisé ce départ, comment n’ont ils pas ordonné un couvre-feu qui ait obligé les Parisiens à rester chez eux ? Quand nous arrivons à l’Opéra, la nuit tombe. La foule est nombreuse. Les colonnes allemandes de camions passent sans discontinuer sur les boulevards. Un bruit continu de roulement emplit la rue. D’autres camions le long des trottoirs poursuivent leurs chargements. Appels en allemand, phares qui s’allument et toujours la foule qui contemple en silence ce nouvel exode comme une revanche. Nous revenons par la Madeleine, par la Concorde où passent dans la nuit l’ombre des tanks, monstrueux. Boulevard Saint-Germain des voitures allemandes sortent encore du Ministère de la Guerre. Quand nous arrivons place de l’Odéon des gens qui refluent par la rue Corneille nous arrêtent ; il y a bagarre du côté du Luxembourg et du Saint-Michel : les mitrailleuses et les fusils viennent de tirer. Peur et énervement de Jacqueline. On n’entend cependant pas grand chose. Nous dévions par la rue Racine, hésitons un instant devant la rue Monsieur-le-Prince, traversons plus loin le Saint-Michel et remontons par la rue de la Sorbonne. En arrivant sur la place de la Sorbonne mouvements de gens et de voitures vers le Saint-Michel. Cris en allemand. Un garçon tête nue, dépoitraillé fuit devant nous, puis revient en rasant les murs. La région semble peu sûre. Jacqueline me dira plus tard que c’est de toutes ces journées parisiennes d’août ce moment où elle a eu le plus peur. C’était le commencement et manque d’habitude. Nous rentrons sans à-coup à la maison. Le poste de police est occupé par un poste de secours marqué d’une Croix-Rouge. De tous jeunes secouristes en casque blanc sont sur le devant de la porte.
(1) Grand café à l’angle de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel. (2) Les Allemands occupaient les cafés au pied des immeubles entre la rue Monsieur-le-Prince et la rue de Tournon. (3) Librairie et café boulevard Saint-Michel ; hôtel Trianon rue Vaugirard proche du boulevard Saint-Michel et occupé par les Allemands.
Vendredi 18 août
Paris allégé. Je descends sur le Saint-Michel pour prendre la température et voir les dégâts. Des balles ont étoilé de nombreuses devantures. L’algarade d’hier soir a du être assez vive. Rien que dans les vitres du cinéma à coté de chez Coudert (1), une vingtaine de balles ont laissé leurs marques. Quelques voitures allemandes ramassent les derniers Allemands devant le Trianon. Est-ce aujourd’hui ou hier que j’ai vu aussi s’embarquer sous la garde de guetteurs armés de mitrailleuses les miliciens qui occupaient le lycée Saint-Louis (2) et ceux qui occupaient le lycée Louis-le-Grand (3), avec une certaine hâte honteuse sous l’œil de quelques passants ? La Soldatenheim au coin de la rue de Médicis est complètement évacuée, glaces cassées, massifs renversés, débris partout. Plus loin cependant le Luxembourg reste gardé, occupé. Le grand drapeau à Croix Gammée flotte encore sur la porte. Un tank reste à l’entrée de la rue de Tournon. Nous pensons que cette arrière-garde va bientôt partir. L’après-midi pour jouir un peu de cet air de demi-liberté nous sortons à pied avec Jacqueline. C’est alors que nous sommes un peu assombris par cette garde du Sénat et ces camions et ces tanks le long desquels nous descendons la rue de Tournon. Nous allons jusqu’à la rue de la Chaise. Le bruit court que déjà sur les murs de Paris des affiches alliées sont collées invitant les hommes à s’enrôler. Quénu (4) a vu je crois rue de Seine une pancarte indiquant que dans ce local que viennent d’évacuer les Allemands, s’installe le siège de la résistance polonaise. Nous-mêmes, tout à l’heure en passant place Saint-Sulpice avons lu dans les encadrements officiels d’annonces, des journaux clandestins affichés, l’un d’eux en particulier rapportant les faits d’Oradour. Il semble que Paris soit rendu à la Liberté : pourtant cette Croix Gammée encore au Sénat…
Les Autorités d’occupation ont décidé de fixer le couvre-feu à 21h00 à partir de ce soir vendredi 18 août, les laissez-passer sont supprimés. A. Bussière, Préfet de police.
Puis à notre retour de la rue de la Chaise un rappel brutal à la réalité : avis affichés, signés du Commandant Militaire de Paris et fixant pour ce soir le couvre feu à 9 heures. Ce sont donc encore eux qui commandent. Peut-être est ce pour faciliter le départ des dernières unités et éviter les incidents, les mitraillades d’hier soir. On regrette même qu’ils n’aient pas déjà pris cette précaution hier soir. En tous cas ce rappel diminue la légèreté de l’air. Nous rentrons à la maison. Et bientôt pour 9 heures en effet la place du Panthéon se vide et prend son grand air de désert, de solitude et de silence. Il faut attendre encore quelques jours pour la délivrance.
(1) Coudert : propriétaire du 15, place du Panthéon ; avait une boutique de coutellerie boulevard Saint-Michel à côté du cinéma Le Latin à droite en montant un peu plus haut que la rue Racine. (2) au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Vaugirard. (3) rue Saint-Jacques. (4) Quenu : chirurgien, ami d’internat de Charles, habitait rue de l’Université.
Samedi 19 août
Toujours la grève des agents. Quand je rentre du PLM (1) la place du Panthéon est encore toute animée. Le drapeau tricolore vient d’être hissé à la porte de la mairie accueilli par la Marseillaise. Des femmes à genoux. Une espèce de joie et d’allégement flotte sur la place. Déjà aux maisons apparaissent quelques petits drapeaux. Les Massonet (2) et un des étages supérieurs en arborent un. Je descends avec Marie-Claire humer à travers les rues cet air de libération. Boulevard Saint-Michel, au lycée Saint-Louis, même cérémonie qu’à la mairie du Panthéon. Groupe de gens autour du drapeau qu’on hisse. Bravos. Des voitures allemandes passent paisiblement. De l’une descendent deux officiers qui demandent leur chemin aux passants. Un peu plus loin, au coin du boulevard Saint-Germain deux fantassins allemands avec tout leur barda, le casque à la main, sont arrêtés comme attendant quelque voiture qui les emmène rejoindre les troupes parties depuis deux jours. Quand nous arrivons sur le Pont Saint-Michel nous apercevons sur la Préfecture, aux quatre coins un grand drapeau tricolore flottant dans le ciel ensoleillé.
La Préfecture de police vue de l’Hôtel-Dieu
Il y en a aussi sur l’Hôtel-Dieu. Devant la porte de la Préfecture, sur le Parvis, attroupements où se reconnaissent comme l’autre jour les agents en civil. On est en train de mettre un drapeau à la porte. L’attroupement a l’air assez excité, figures d’insurgés, brassards de F.F.I. Entre les mains de l’un de ceux qui est devant la porte, une mitraillette. Ça sent la poudre. J’ai hâte maintenant de ramener Marie-Claire. Nous revenons par le quai chercher des graines pour les oiseaux (3), puis par la rue Lagrange et la rue des Carmes. Quelques drapeaux aux fenêtres. Au marché Maubert on vend à pleins paniers des cocardes tricolores. Quand nous arrivons place du Panthéon les drapeaux de la maison ont disparu. Une motocyclette allemande vient de passer. Devant la bibliothèque de la Montagne-Sainte-Geneviève (4) elle a tiré sur un groupe de jeunes gens. L’un d’eux a été tué ou blessé (*). Un brancard se hâte pour le transporter au poste de la rue Cujas.

(*) Claire indique la présence aujourd’hui sur le pilier nord-ouest de la grille du Panthéon d’une plaque : Alexandre Massiani, gardien de la paix, tué pour la Libération de Paris. En fait les soldats allemands voulaient disperser violemment une cinquantaine de personnes massées sur la place du Panthéon. Constatant les brutalités commises, Massiani, 34 ans, dégaine son arme pour intervenir mais est aussitôt mitraillé par le passager d’un side-car.
Ça sent de plus en plus la poudre. Les drapeaux se retirent des fenêtres, les gens rentrent chez eux. Vers midi le bruit commence à se répandre dans la rue et par téléphone d’un couvre-feu à 2 heures de l’après-midi. On perçoit une menace dans l’air. Tout le monde est aux aguets, sur le trottoir devant sa porte, aux fenêtres. Vers 2 heures en effet la place se vide. Puis de la mairie sortent une centaine d’employés hommes et femmes qui, se hâtent de rentrer chez eux. Alors commence pour nous, et d’abord incomprise, la première figure de ce que sera l’insurrection de Paris. Dès que sont partis les employés de la mairie, 4 ou 5 hommes en civil groupés près du poste de secours en sortent les sacs à terre qui protégeaient depuis longtemps les fenêtres, se les passent de main en main jusque sur le trottoir. Dirait-on déjà un petit parapet ? Ou simple débarras de sacs ? Mais voici que s’amorce une chicane. C’est bien un petit fortin qui est en train de se construire. La guerre commence. Le petit fortin encadre bientôt l’entrée du poste et le rentrant vers la mairie. Je reconnais s’organisant autour ou à l’intérieur du fortin un groupe d’agents en civil avec tous les brassards ou tricolores marqués FFI, ou de couleurs diverses. Dans la journée, sortant du lycée Henri IV une bande de 5 ou 6 insurgés : cheveux au vent, poitrine ouverte, pantalons remontés au genou s’avancent, tenant un fusil ou serrant un revolver, rejoignent le poste. De plus jeunes encore s’y aggloméreront. Les agents ont leurs casques noirs à cimier d’argent, d’autres des casques gris 75, d’autres enfin des casques rouges. Deux ont un uniforme complet d’officier français. Tous portent brassard. Nous commençons d’entendre des coups de feu. Le bruit court qu’on se bat sur le Parvis de Notre-Dame. A certains moments, véritable fusillade et même canon. Nous apprenons que les agents sont retournés à la Préfecture de Police et que les Allemands attaquent la Cité avec de l’infanterie et des chars. Des combattants de notre poste se détachent parfois pour se porter de ce côté. Le soir les bruits s’apaisent. Le poste reste animé. Puis quand la nuit vient un incendie embrase le ciel derrière le Panthéon et son dôme. Nous montons au 7° étage (5). L’incendie est dans la Cité. Nous le localisons aux environs de la Préfecture de Police et nous pensons que c’est elle qui brûle. De brusques volutes de flammes éclairent le clocher de la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, les maisons voisines. D’autres incendies à l’horizon de Paris. Le lendemain nous apprenons que ce n’est pas la Préfecture qui a brûlé mais sur le pont au bas de la rue Saint-Jacques, des camions de munitions ou d’essence dont nous apercevons en effet, depuis la rue Soufflot, les carcasses calcinées.
(1) Charles était médecin au Paris-Lyon-Marseille, le service médical du PLM était à l’intérieur de la gare de Lyon sur un quai latéral. (2) Massonet : ils habitaient au rez-de-chaussée. (3) Deux perruches : Nisou et Cacou. (4) De l’autre côté du Panthéon par rapport à la maison. (5) Les chambres de bonnes du 7° étage donnaient sur la place avec une vue au-delà du Panthéon.
Note supplémentaire de Marie-Claire au récit de son père sur le 19 août : Auparavant le drapeau avait été hissé à l’École de Droit. C’est en passant rue Saint-Jacques que nous avons vu deux drapeaux tricolores sur la Préfecture, ce qui nous a incités à y aller, et lorsque nous y sommes arrivés nous avons vu qu’il y en avait quatre.
Dimanche 20 août
La nuit a été calme. Le matin j’accompagne Denise au pain. Le poste de la Résistance est toujours sur pied d’alerte. Des jeunes, armés de revolvers, quelques uns avec un fusil, de très rares avec une mitraillette vont et viennent autour du poste, ou d’un poste à l’autre (vers le lycée Henri IV et la rue des Fossés-Saint-Jacques). Queue au pain. La rue Mouffetard est plus animée que de coutume. La foire aux puces est maigre (1). La matinée et surtout l’après-midi, vives fusillades et canonnades dans la direction de la Cité. Fusillades également de notre poste au poste allemand du Luxembourg. Puis le bruit commence à courir, et nous arrive par divers téléphones qu’une trêve est intervenue, une suspension d’armes entre la Résistance et les Allemands – et que ceux ci reconnaissent la qualité de combattants à leurs prisonniers. Cependant la fusillade crépite. Vers 5 heures, devant le poste de la mairie, un clairon sonne le « cessez-le-feu ».
Un policier monté sur une voiture allemande annonce la trêve dans les rues de Paris. Son collègue sonne le cessez-le-feu devant le parvis de Notre-Dame.
Toute la place s’anime. Nous décidons, sur un coup de téléphone d’Henri Dupuis (2), d’honorer la promesse de bridge faite aux Lagarenne (3). Pendant que nous y sommes des avions survolent Paris, reçus par une forte canonnade de la défense anti aérienne. Quand nous traversons la rue Gay-Lussac, des coups de mitrailleuse et même de canon viennent d’être tirés. On ne croît qu’à moitié à la trêve. Nous évitons le boulevard Saint-Michel et descendons la rue Saint-Jacques jusqu’au boulevard Port-Royal. Jacqueline a envie à chaque instant de rentrer et de me laisser seul. Nous traversons sans ennui le grand espace au croisement de Port-Royal et de Saint-Michel – et rapidement ! J’aperçois sur le Saint-Michel vers le Luxembourg des tanks allemands. Quand nous arrivons à l’entrée de la rue d’Assas nous voyons passer sur le Saint-Michel une voiture allemande; des coups de feu sont échangés. Que faire ? Aussi difficile de continuer que de reculer. Je continue entraînant Jacqueline par la rue d’Assas. Nous voici au lycée Montaigne. Le barrage allemand est là, les sentinelles casquées et en arme. Nous passons un peu serrés et émus et nous trouvons Henri chez Lagarenne. Le bridge manque d’ (illisible). Le bruit des fusils et du canon arrive jusqu’à nous. Par le même chemin nous regagnons la maison avec le même serrement à passer devant le poste du lycée Montaigne. Il apparaît bien que cette trêve n’a été ni généralisée ni complète. Le même état d’alerte continue dans tous les postes; cependant le pavoisement recommence, au moins dans la rue Curie nous voyons l’hôpital et toutes les maisons voisines flottantes de drapeaux. Il n’y en a point place du Panthéon : la leçon du vendredi a porté fruit.
(1) Tous les dimanches se tenait une sorte de brocante rue Rollin. (2) Henri Dupuis : ami d’enfance de Charles ; habitait rue de Belleville. (3) Lagarenne : ami d’enfance de Charles ; habitait rue Madame du côté opposé au Panthéon par rapport au Luxembourg.
Note supplémentaire de Denise ou Marie-Claire : Rue Gay-Lussac passent six tanks. Effroi des gens. Silence dans les queues. Le bruit court aussi que les Américains sont tout près de Montrouge
Lundi 21 août
Au petit matin activités du poste de la mairie. En arrivant à la gare de Lyon (1), la rue Traversière est barrée sur la rue de Bercy. Derrière le barrage un camion allemand, grande Croix Gammée et des cheminots allemands en arme. La rue est également barrée sur la rue de Lyon. Les bagarres provoquées sur ce poste ont été nombreuses. Des civils ont été tués jusque dans la bouche du métro de la gare, d’autres molestés. Des branches de platane jonchent encore le sol.
Le barrage du carrefour Traversière/Bercy surveillé par les cheminots allemands et l’entrée du métro boulevard Diderot où les frères Mordrel d’Alfortville ont été traînés de force après leur arrestation rue de Lyon le 20 août à 13h00. Roger, 19 ans, a été tué sur le coup, Henri, blessé à la mâchoire, a fait le mort et pu s’enfuir. Lire : Le tueur de la gare de Lyon.
A Bon Secours (2), naturellement très peu de monde. J’en reviens par l’avenue d’Orléans. Sur le Saint-Michel des gens du quartier achèvent d’emmener les planches et les pieux qui, sur la place de l’Observatoire, fermaient le Petit-Luxembourg. Le Saint-Michel est désert. Au coin de la rue Auguste-Comte le blockhaus à l’angle du jardin à ras de terre est garni. Des meurtrières, les fusils dépassent vers la rue. Silence. Je défile devant les fusils aussi tranquillement que je peux. Plus loin, à l’entrée de la rue Soufflot, le petit fortin de planches qu’ils avaient construit les jours derniers et qui avait été démoli en partie hier, est renforcé par un petit fortin de sacs à terre; sept ou huit Allemands l’occupent, les uns fusil à l’épaule, les autres, fusil en position sur le parapet des sacs. Même silence et même désert sur le boulevard. De nouveau aussi tranquillement que je peux, je défile devant le poste et je m’engage rue Soufflot que sans accident je monte jusqu’à notre poste de FFI. La prochaine fois quand je reviendrai de Bon Secours mieux vaudra prendre une autre voie. L’après-midi reste agitée devant le poste. Des coups de feu s’échangent d’un bout à l’autre de la rue Soufflot. Jacqueline ne quitte guère la fenêtre. Des alertes : on annonce que les chars vont monter, on renforce les sacs à terre du poste. Les fenêtres de l’École de droit sont garnies de mitrailleurs à genoux derrière les persiennes. Aux coups de sifflet tous se préparent, des insurgés s’embusquent à l’angle de la rue, les mitrailleuses se braquent, certains vont se coucher à plat ventre, fusil à l’épaule, à l’ abri de la mairie. Jacqueline tire les persiennes (3). Puis à nouveau le calme se rétablit jusqu’à de nouvelles fusillades et de nouvelles alertes. Vers les 6 heures je suis allé à ma table de travail, toutes fenêtres ouvertes. Depuis un moment je perçois un bruit de roues pesantes quand j’y prête attention – et déjà reconnais le roulement des chars. Je vais à la fenêtre : débouchant de la rue Soufflot un petit tank allemand; sur le devant du char, bras nus, chemise ouverte, un allemand est assis. Il est suivi d’un gros char porteur (?) du canon à long tube puis d’un 3ème petit char. Silence de mort sur la place. Silence et désert au poste. Les trois chars passent, contournant le Panthéon par devant la Bibliothèque Sainte-Geneviève et disparaissent. Cent kilos quittent les poitrines. Des casques apparaissent de nouveau au dessus des sacs à terre. Les persiennes qui s’étaient fermées se rouvrent. Les tirailleurs reparaissent aux fenêtres de l’École de Droit. Mais tout cela encore timidement. De nouveau silence et désert : le bruit des chars qui reviennent. Dans le même silence et la même immobilité du paysage, ils réapparaissent devant la Bibliothèque Sainte-Geneviève, puis s’engagent rue Soufflot. Pas un coup de feu, pas un geste. Tout à coup ils stoppent juste devant le poste. Les cœurs se serrent. Une sorte de flamme jaillit à l’arrière d’un char, mais sans détonation : simple retour par un pot d’échappement. Les tanks reprennent leur route par la rue Soufflot et disparaissent. Il faut quelques minutes pour que se soulève le couvercle de terreur et de silence qui pèse sur la place. Démonstration ? Reconnaissance ? Surveillance ? Ils ont fait en tous cas l’épreuve (la preuve ?) de leurs forces. Que faire contre une telle force ? Il leur suffit de se montrer pour que tout rentre sous terre. Que sera-ce si vraiment elle se déchaîne ? Nous pensons à Varsovie où le déchaînement prématuré de l’insurrection intérieure a déclenché de terribles représailles et la destruction de la ville.
(1) Pour le service médical du PLM. (2) Hôpital Notre-Dame-du-Bon-Secours, rue des Plantes dans le 14ème où Charles avait le service de gastroentérologie. Tenu par les Augustines de l’Hôtel-Dieu à la fois hospitalières et cloitrées à l’intérieur de leur communauté dans l’hôpital. (3) Persiennes en fer qui se replient ; depuis plusieurs années les lamelles interstices avaient dû être remplies de papier journal pour les nécessités de la Défense passive ; sans doute en enlevait-on quelques éléments pour voir.
Mardi 22 août
Je vais de bonne heure ouvrir les fenêtres sur le champ de bataille. La place est calme. Quelques passants. Le poste de la mairie continue de renforcer ses sacs à terre. Les insurgés sont dedans et autour en petit nombre. Matin d’automne ensoleillé, un peu brumeux et frais. Je sors pour voir, et aussi pour aller à la clinique de la rue de la Chaise. Dans la rue Soufflot deux ou trois hommes ont arraché les pavés et dressent un petit mur en travers de la rue à la croisée de la rue Saint-Jacques. Ils se hâtent avant que les tirailleurs allemands aient garni le petit poste qu’ils occupent habituellement boulevard Saint-Michel. Ce petit mur n’est pas à proprement parler une barricade. Très utilement il masque le sol de la place du Panthéon aux vues du poste allemand devant le bassin de la place Edmond-Rostand et du blockhaus du Luxembourg. Rue Cujas la Poste est fermée. C’est bien la grève annoncée depuis hier. On est toujours à se demander si cette grève a une orientation uniquement antiallemande ou si déjà le Communisme prend ses positions. Le boulevard Saint-Michel est peu animé. Voici des journaux qu’on s’arrache devant la Librairie allemande (1). Les premiers journaux de la « Libération ». Les journaux d’obédience allemande ont disparu depuis il me semble vendredi ou samedi. Hier soir les FFI ont bien distribué, un par maison, un journal de petit format. Il n’est pas arrivé jusqu’à nous. Ceux d’aujourd’hui se vendent librement. Il apparaît bien que les Allemands, ou se désintéressent de la question, ou n’ont plus les moyens suffisants pour empêcher l’impression et la distribution à ciel ouvert des journaux soulevés contre eux.
Lire l’article sur la presse de la libération
Et dire qu’il y a quelques jours un tract clandestin trouvé sur vous suffisait à vous faire enfermer, peut-être fusiller… Difficile à comprendre cette longanimité des Allemands qui ont encore en somme le pouvoir sur Paris, ou du moins qui semblent encore suffisamment armés pour le garder. Plus loin le boulevard Saint-Michel est barré d’une belle barricade, platanes renversés, pavés arrachés, grilles d’arbre, voiture. Des miliciens, jambes nues, mitraillettes au poing gardent des travailleurs qui complètent la barricade. Interdiction de passer. Comme on s’est beaucoup battu dans la région de la Place Saint-Michel et du Pont-au-Change, cette barricade semble défendre cette région contre les incursions des chars du Luxembourg. Je remonte sur mes pas, puis par la rue de Vaugirard. De la rue de Vaugirard j’aperçois les guetteurs allemands devant l’aile droite du Sénat, face à l’Odéon. Ils surveillent face à eux ; des tireurs placés comme je suis les atteindraient avec facilité. Je dérive par la rue Monsieur-le-Prince puis par la rue Racine. En passant devant l’Odéon par les perspectives de la rue Corneille puis de la rue Rotrou puis de la rue de Condé, je vois passer devant le Sénat des tanks en direction de la rue de Médicis. Je commence à être inquiet (2). Plus loin descendant la rue de Condé avant de tourner rue Saint-Sulpice, je vois refluer du boulevard Saint-Germain, par la rue de l’Odéon, toute une volée de cyclistes. Des tanks avancent par le boulevard Saint-Germain en direction du boulevard Saint-Michel. Décidément ça sent la poudre. Pourtant je vais jusqu’à la Clinique de la rue de la Chaise. Le boulevard Raspail reste agité. Des patrouilles allemandes arrêtent et fouillent les cyclistes ou les passants suspects, devant Lutetia (3). Le bruit des fusillades et du canon recommence. A mon retour, devant l’Odéon le canon tonne tout proche. Un groupe de gens à l’entrée de la rue Racine ne savent par où passer. J’apprends que les tanks sont allés attaquer la mairie du 5ème. Ainsi la démonstration muette et menaçante d’hier soir était une reconnaissance. J’ai hâte de savoir ce qui s’est passé là-bas. Quand j’ai quitté la maison Denise partait pour faire la queue au pain. Marie-Claire dormait. Jacqueline était déjà au ménage. On me dit aussi qu’un tank placé place Rostand balaie le boulevard Saint-Michel à coups de canon. Impossible de remonter par la rue Corneille. Un monsieur avec moi, FFI sur son brassard, qui doit rejoindre la rue Toulier me dissuade de traverser le Saint-Michel. Comme des gens passent avec une sorte de tranquillité rue Monsieur-le-Prince, nous voilà tous deux engagés et remontant la rue. En arrivant au boulevard Saint-Michel, le tank nous apparaît devant la Soldatenheim, son long tube de canon tourné vers le Saint-Michel. Il est pour l’instant muet. Mon compagnon de rencontre et moi même hésitons, puis tant pis, à la chance, juste au dessous du tube du canon nous traversons. Nous voilà au coin de la rue Soufflot, dans le pan coupé de la porte de Capoulade. Le petit fortin allemand devant le bassin est garni de tirailleurs allemands, dépassant à mi-corps les sacs à terre. L’un d’eux montre du doigt quelque chose ou quelqu’un rue Soufflot. Un gradé à coté de lui prend posément son fusil, l’appuie sur le remblai, vise posément, tire et repose son fusil.
Char posté dans les jardins du Luxembourg
Sur le tank deux jeunes garçons rajustent leurs cheveux et leurs vêtements. Le Saint-Michel est jonché des branches arrachées aux platanes. Collés à la porte du Capoulade nous assistons à cette scène à la fois dramatique et calme. Une femme à trois pas devant nous, au bord du trottoir, un panier à la main regarde. Du café Mahieu, de l’autre coté de la rue Soufflot, on lui crie de se retirer : “Je vous emmerde, qu’est ce que ça peut vous foutre et à moi d’avoir une balle dans la peau”… Impossible de partir par la rue Soufflot, champ de tir pour les fusils allemands et pour ceux de notre poste en haut de la rue Soufflot. Sur le Saint-Michel on ne va tout de même pas tirer le canon pour nous, d’autant que les canonniers nous regardent de la façon la plus paisible à 4 ou 5 mètres de nous. Nous descendons en apparence au moins tranquilles, les pas un peu pressés, les fesses un peu serrées jusqu’à la rue Cujas. Nous voici défilés (?) et la respiration plus à l’aise. J’abandonne mon compagnon rue Toulier, je contourne le Panthéon et j’aperçois notre façade et celle du 13 maculées par les balles. Jacqueline est à la fenêtre, les enfants vivants. Ce sont eux qui vont me faire le récit de l’attaque : Denise était à la queue au pain rue des Fossés-Saint-Jacques où le bruit est arrivé que les tanks montaient la rue Soufflot. Elle revient par la rue Clotaire. Les tanks arrivent. Elle reflue sans pouvoir gagner la maison et tâche de contourner par la rue d’Ulm. Les tanks sont en vue. Elle se réfugie dans une maison de la rue des Fossés-Saint-Jacques. Jacqueline à la maison, à la fenêtre. Aucun mouvement spécial au poste, les tirailleurs derrière les sacs ne bougent pas. Plutôt une sorte de silence prémonitoire. Tout d’un coup apparition au bout de la rue Soufflot, sur le trottoir devant l’École de droit, de deux soldats casqués allemands, si calmes, regardant à droite, à gauche, derrière eux qu’elle les prend pour des FFI déguisés en Allemands. Les soldats regardent vers la fenêtre et font signe comme pour indiquer de la fermer, puis lèvent le fusil dans la direction pour appuyer l’avertissement. Jacqueline tire sa persienne. Au même moment violent coup de canon et le poste disparaît dans un nuage de fumée. Alors Jacqueline comprend et file à la cuisine (4) où se trouvait déjà Marie-Claire… puis naturellement revient voir : un tank évolue sur la place et s’arrête devant l’École de droit. Un autre tank sur la place, plus grand, armé du canon à long tube fait face au poste. Pendant ce temps la femme de ménage de la fenêtre du salon voit le canon tourner et se diriger vers nous. Mais la pétarade a éclaté et de nouveau tout le monde se réfugie à la cuisine. Elles entendent siffler des balles. Quand tout a été calme elles reviennent aux fenêtres. Des gens ressortent dans la rue. On annonce qu’il y a une trêve pour ramasser blessés et morts et que les tanks vont remonter.
Ramassage de blessés (photo de droite : boulevard Saint-Michel)
La Croix-Rouge arrive et sort des brancards. Les uns emportent des blessés. J’en ai croisé un, moi-même, rue Cujas. Ils emportent aussi sur leurs brancards, sous des bâches noires protégées par le drapeau à Croix-Rouge, des masses qu’on dit d’ abord être des cadavres, mais qui semblent bien avoir été des caisses peut être de munitions. En même temps un FFI armé saute par dessus les sacs éboulés, suivi d’un civil en bras de chemise, dépoitraillé, bras en l’air. Va t’on le fusiller ? Quelques minutes d’attente puis par le même chemin, un à un sortent une trentaine de prisonniers civils (dont 2 ou 3 femmes), haut les mains. Sous l’escorte de quelques FFI armés ils s’en vont par la rue Clotaire. Quand j’arrive la place est atterrée. Sur le trottoir de la maison des morceaux de balustre arrachés au balcon. Des obus ont pénétré la fenêtre de Madame Massonet au rez-de-chaussée, des balles aussi. A notre étage les carreaux de la chambre sont traversés par une douzaine de balles. C’est bien plus tard qu’avec Marie-Claire nous en suivons la direction jusque vers le lit que Jacqueline a refait sans rien voir. Nous retrouvons le traversin éventré, perdant ses plumes, une balle dans le mur derrière le lit, une chemise de balle éclatée dans le matelas. Il n’a pas été possible de retrouver les autres balles. L’une cependant a déchiré un vêtement posé sur le fauteuil près de la fenêtre. Toute la maison est terrorisée. On craint que les tanks ne remontent. Un locataire fait courir la nouvelle que récemment les Allemands au cours d’une expédition semblable rue d’Armaillé ont fait descendre tous les hommes d’une des maisons attaquées et les ont fusillés sur le trottoir. Un certain nombre fuit la maison. Mais rien ne se passe. Les Allemands après leur expédition punitive ont passé avec leurs chars devant la Bibliothèque Sainte-Geneviève et sont partis par la rue Clovis où ils ont mitraillé le lycée Henri IV puis ont dû rentrer au Luxembourg. Je m’en vais avec les enfants jusqu’au poste attaqué. Il est vide de tout combattant; des obus ont défoncé les cloisons intérieures, tordu les grilles de la porte de la mairie, bouleversé les sacs à terre.
La mairie du 5ème arrondissement et son poste de police après la libération
Tout cela a été tiré à balles ou obus non éclatants et les dégâts sont relativement peu importants. Rien n’empêchera que le poste soit bientôt réoccupé. Ainsi s’avère la double inefficacité du combat : les nôtres sont impuissants contre les forces régulières allemandes, contre leurs tanks, contre leurs nids de résistance. Ils n’agissent surtout que contre les isolés, contre les camions ou voitures traversant Paris. Pourtant on m’a rapporté plusieurs exploits d’attaques héroïques et heureuses contre les chars, mais je les crois exceptionnelles. D’autre part les Allemands ne peuvent que peu de choses contre cette émeute multiple, dispersée, reformée. Leurs chars arrivent, crachent obus et balles, trouent une fenêtre, un mur puis rentrent à leurs bases. Mais ne vont-ils pas, un jour ou l’autre, attaquer vraiment avec leurs forces, leur infanterie, leurs avions, leurs mines; prélever des otages, incendier des maisons, fusiller ? C’est cette menace plus que les dégâts qui étend aujourd‘hui sa terreur sur la place du Panthéon. Madame Monnet (5) que je rencontre sur le trottoir me précise qu’à cette attaque du Panthéon il y avait non seulement les deux fantassins que Jacqueline m’a signalés mais une troupe de 100 à 150 hommes qui accompagnaient les chars. Ils ne semblent pas être entrés au poste. Ils auraient eu deux blessés, au moment de leur arrivée, par des coups de fusil tirés du poste. Le poste cependant n’a pas dû tirer beaucoup. Malgré tant d’obus et de balles lancés contre eux, ils n’ont eu aux derniers renseignements que deux blessés. Tous les autres se sont enfuis par les couloirs intérieurs de la mairie, vers la rue des Fossés-Saint-Jacques. Photographies du poste après l’attaque (6). Le reste de la journée la plupart des locataires évacuent la maison. Je rassure le mieux que je peux Jacqueline et nous décidons de rester. Maintenant que l’attaque qui nous menaçait a eu lieu, il me semble que nous sommes vaccinés et protégés. Jacqueline finit par admettre cette théorie et le reste de la journée et la nuit passent d’abord sans incident. Mais voici que vers minuit des explosions, il me semble assez proches, me tirent du sommeil. J’entends d’abord comme un bruit assez sourd, puis qui redouble et forme comme une brutale explosion, secouant vitres et portes. Ces sortes d’explosion se répètent à 5 ou 10 minutes d’intervalle. Un bruit d’avion au dessus de nous. J’éveille Jacqueline. Marie-Claire et Denise arrivent. Les explosions deviennent d’une violence extrême. Les Massonet ont, en bas (7), l’impression qu’une troupe de gens secouent les fenêtres et la porte de leur maison et nous demandent refuge. Ils viennent s’asseoir dans le petit couloir de la maison. Cependant, de mon lit je peux prévoir ces explosions en attendant d’abord le premier bruit comme un coup de départ. Le tout a duré 1/2 heure ou 3/4 d’heure. Le lendemain toutes les hypothèses ont été soulevées : des dépôts de munitions explosent dans le Bois de Vincennes, des péniches chargées de munitions explosent sur la Seine, des munitions dans les souterrains du métro, des pièces d’artillerie bombardent Paris depuis la région de Vincennes. Je n’ai jamais su, même les jours suivants l’origine exacte de ces détonations assez terrifiantes.
(1) Place de la Sorbonne à l’angle du boulevard Saint-Michel. (2) Pour des tanks c’est la route obligatoire vers la place du Panthéon. (3) Grand hôtel boulevard Raspail / Sèvres-Babylone. (4) La cuisine est au fond d’un long couloir protégé des tirs sur la façade. (5) Jean Monnet (le plan Monnet) habitait rue des Fossés-Saint-Jacques juste derrière chez nous, ils étaient amis avec les parents. (6) A ce jour je n’ai retrouvé ni les photos ni les négatifs (Claire). (7) Au rez-de-chaussée et leur cuisine est au sous-sol
Mercredi 23 août
La place du Panthéon reste encore atterrée, groggy et le restera toute la journée. Plus d’insurgé révolver au poing; les sacs à terre restent dispersés; les fenêtres restent sans curieux. Le silence s’étend sur tout le quartier. Quand je rentre de la Gare de Lyon, au bout de la rue Buffon, à l’angle de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, trente personnes font la chaîne, hommes et femmes, fillettes, entre un dépôt de matériel d’entreprise dont la porte a dû être enfoncée et l’entrée de la rue Buffon. On dresse une barricade de pavés, sacs à terre, grilles d’arbres, ou du moins deux barricades partant toutes les deux de l’entrée du Jardin des Plantes à angle droit pour barrer la rue Buffon et la rue Geoffroy. Rue Monge une autre barricade. Comment les Allemands vont-ils réagir ? Je pense au sort des maisons près desquelles sont les barricades et de leurs habitants. Je continue mon chemin vers Bon Secours. La place devant l’Église de Montrouge (1) est de traversée dangereuse. Bataille à la porte d’Orléans. Un char allemand s’y est installé. Toute la matinée de Bon Secours nous entendons les canons des tanks, à coté de nous. Dans l’après-midi canonnades dans Paris assez loin. Le téléphone nous apprendra une grande bataille dans le 8° arrondissement, particulièrement sur la place Saint-Augustin et devant le Cercle Militaire. Des maisons du boulevard Haussmann ont été attaquées à coup de canon. Tout le quartier est resté en état de siège pendant plusieurs heures. Marthe (2) qui était allée à l’Institut dans l’après-midi a eu toutes les peines du monde à rentrer chez elle, se heurtant à chaque coin de rue ou de place ou aux postes allemands, ou à la fusillade. C’est par la rue Cambon que finalement des guetteurs allemands l’ont dirigée. Mais je n’ai eu que des détails imprécis qu’elle s’est chargée de compléter. Cette journée a été appelée à Paris “la Journée des Barricades”.
Exemples de barricades
Elles avaient déjà commencé les jours précédents mais c’est ce jour-là et le lendemain que vraiment tout le pavé de Paris, des grandes artères aux moindres, s’est soulevé. Malgré cela, les Allemands tiennent des quartiers entiers. Ils laissent faire les barricades presque sans réaction. On s’attend à chaque instant à des expéditions, à des représailles, à un écrasement de Paris, à un déclenchement de l’aviation, à des tirs d’artillerie. Je vais en consultation à bicyclette voir un malade avec Dupuy jusqu’au fond de l’avenue Jean-Jaurès. Dans tous ces quartiers non seulement le calme est parfait mais il n’y a aucune de bataille. C’est une sorte de dimanche populaire à travers les rues de Meaux, de Bolivar, de Jaurès. Marché de salades, gens à travers les rues, sur le pas de leur porte, petites voitures à la sauvette. J’achète deux romaines. En rentrant à 17 heures je trouve l’émoi place du Panthéon : des FFI armés passent rapidement, d’autres retiennent les passants. Que se passe-t-il ? Je pousse prudemment ma bicyclette. J’aperçois devant la maison, aux aguets, des insurgés, arme au poing. Au coin de la rue d’Ulm l’un d’eux, fusil braqué, m’empêche d’accéder à la maison. Je passe par derrière la rue des Fossés, puis par la rue Clotaire. Émoi aussi dans la maison : les FFI viennent d’y faire une perquisition. Des coups de feu tous ces jours auraient été tirés des toits contre eux. Notre maison est suspecte. Cinq insurgés sont montés, armes au poing, accompagnés de la concierge ; d’abord chez les Waroquier (3) puis chez les Augier (4), assez brutalement. Marie-Claire a dû monter les clefs des chambres de bonnes qui ont été visitées (5). Les tirailleurs en bas, ceux que j’ai vus, protégeaient cette expédition. Interdiction est faite aux Waroquier et aux Augier de fermer leurs persiennes même la nuit. Ce soir-là, madame de Waroquier part avec sa valise coucher ailleurs. Il ne restera dans la maison que la concierge, les Massonet et nous. Puis nuit calme. Que nous réserve la journée de demain ? Les Allemands ne vont-ils pas réagir plus brutalement et plus efficacement ? Il serait temps aussi bien contre la menace allemande que pour les désordres de la rue qu’arrivent les Américains.
(1) A Alésia, au carrefour de l’avenue du Maine. (2) Une des sœurs de Charles ; elle habitait avec son mari Jean-Charles Moreux avenue Matignon et assurait une consultation à l’Institut Vernes rue d’Assas. (3) Henri de Waroquier, peintre, habitait au 6ème étage. (4) Les Augier habitaient au 3ème étage. (5) Je me souviens parfaitement de cela. Ma mère m’a dit « Tu dois monter au 6ème par l’escalier de service (sans ascenseur) et ouvrir les chambres ». Des FFI en armes, grenades à la ceinture m’attendaient. En montant j’ai dit « Ça me fait peur (sous-entendu : ces armes) » L’un d’eux a répondu «Quand on n’a rien à se reprocher on n’a pas de raison d’avoir peur ». J’avais treize ans et avais été très bouleversée par les jours précédents. J’ai pu cependant atteindre les chambres du 6ème sans encombre. (Claire)
Jeudi 24 août
Matinée calme au Panthéon. C’est ce matin là qu’a eu lieu l’attaque du poste de police et de Résistance du Grand-Palais, l’incendie du Grand-Palais où se trouvait le cirque Rancy. Marthe et Jean-Charles qui étaient à proximité sont chargés de fournir un chapitre. Voir le journal “l’Aube” du 24 août annexé (1).
Les dégâts sont considérables. Lire l’article : l’Attaque du Grand-Palais
Au Panthéon quelques insurgés reviennent au poste sans l’occuper. Dans l’après-midi fusillades et coups de canon des 105 allemands dans la direction de la Cité et du Saint-Michel. Les barricades se multiplient dans Paris. Je descends l’après-midi avec Jacqueline voir celles de la rue Monge, des Gobelins, de la rue Claude-Bernard. Jusqu’à la rue Mouffetard qui a barré son entrée sur les Gobelins, par une solide muraille de pavés. Difficile d’imaginer un intérêt seulement militaire. Est-ce simple réaction populaire qui trouve sa seule preuve sécrétant la barricade, comme les Allemands sécrétaient le béton, ou arrière-pensée révolutionnaire ? Je suis allé ce matin à la gare de Lyon. Des platanes abattus barraient le boulevard Diderot à la croisée de la rue Traversière. Le poste allemand de la rue Traversière a disparu. Des drapeaux français pavoisent la gare. Ce poste de la rue Traversière tenu par des cheminots allemands occupait le grand immeuble SNCF. Un barrage de chevaux de frise le fermait sur la rue de Bercy et la rue de Lyon. Camions et voitures allemands occupaient ce segment de la rue Traversière. Une immense Croix Gammée écussonnait les camions des extrémités. Des sentinelles allemandes armées gardaient les issues. Ce poste terrifiait le voisinage, particulièrement son chef habillé en colonel de l’Afrika Korps, culottes courtes, tuant les passants à coups de carabine. Le Corre avait été fouillé et maltraité. Les Millet n’osaient sortir. Il faisait des sorties hors du poste. Je l’ai vu moi même mercredi, hier, en revenant de chez Dupas (2) par le boulevard Diderot. Il fumait sa cigarette au coin de la rue de Lyon et de l’avenue Ledru-Rollin en inspectant le quartier désert. Les infirmières de la gare de Lyon me racontent leur départ hier mercredi 23 août dans l’après-midi. Ils ont rassemblé leurs voitures, emmené avec eux des otages pris récemment dont neuf pompiers, puis averti par haut-parleur que si il leur était tiré dessus par les passants ou par les fenêtres dont ils ordonnaient la fermeture, non seulement ils mitrailleraient tout mais tueraient les otages. Ils sont partis sans un coup de fusil, en direction de la porte de Charenton. Le sinistre de l’Afrika Korps avait été le matin fait prisonnier au cours d’une de ses sorties et exécuté. Il était tant haï du quartier que sa présence dans le convoi eut sûrement déclenché la bagarre. Une bonne de l’Azur Hôtel, suspectée d’avoir désigné la veille aux fusils allemands le marchand de marrons à sa fenêtre au 6ème et provoqué sa mort vient d’être rasée ce matin et marquée de la Croix Gammée.
Plaque actuelle rue de Lyon et photographie du Musée de la Résistance en ligne
Ce départ du poste, cette disparition du drapeau hitlérien, ce pavoisement français de la gare créent déjà comme un espace et comme un air de liberté. S’ils pouvaient donc tous ainsi partir sans dégât et sans coup férir. Ils ont laissé grand désordre dans les locaux de la gare abandonnés par eux. Gérard met de coté un sac de pâtes de 50 ou 100 kg qu’il distribue. Casques, calots, vestes… Dans l’après-midi, derrière le canon et les mitrailleuses de la Cité, s’entend de plus en plus une canonnade venue du front au voisinage de Paris. Des bruits courent, les Américains seraient à Bourg-la-Reine, à Massy-Palaiseau. Paris est dans l’attente, aux aguets, pendant que continue la mitraillade. Marthe me téléphone que les fortins du 8ème arrondissement tiennent toujours le quartier sous leur terreur. Dans la soirée, tard, quelqu’un me téléphone : on aurait vu une motocyclette américaine rue Daguerre, sur l’avenue d’Orléans. Vers les 8 heures coup de téléphone de Dupuy : les Parat viennent de voir, d’entendre, de toucher les premiers chars français à la porte d’Italie. La nouvelle est sûre. Une délégation serait déjà à l’Hôtel de Ville. La nuit tombe. Les cloches se mettent à sonner sur Paris. Quelques fusées montent de l’Hôtel de Ville. Des coups de fusil aussi. On n’ose encore sortir, on brûle d’y courir. Nous montons dans la chambre de bonne du 7ème étage. La nuit sur Paris, les cloches sur Paris, une rumeur vient de la Cité, puis la Marseillaise. Denise a les larmes aux yeux d’être retenue là pendant que là-bas…
La colonne du capitaine Dronne est venue se ranger devant l’Hôtel de Ville à 21h22
Non, il faut y aller. Je pars avec Denise. Nous franchissons à tâtons dans la nuit la barricade qui barre au coin de Saint-Étienne-du-Mont la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (une barricade contre tank dans la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève !!) Il y a peu de monde, quelques personnes vont cependant comme nous vers la Cité. En arrivant rue Lagrange devant le pont qui mène au parvis, dans la nuit, ombres confuses de voitures renversées faisant barrage. Nous approchons. «Halte-là !” On ne peut passer. Comme les gens hésitent et s’arrêtent un coup de feu du poste enlève toute hésitation. Il faut reculer. Une deuxième tentative faite sur le pont des Tournelles nous arrête à l’entrée de l’Île Saint-Louis. On entend passer dans la rue Saint-Antoine des Marseillaises. Penauds nous regagnons la maison. Coups de feu dans la nuit. Ironie de la maman (Jacqueline). Nous ne sommes décidément pas encore délivrés. Dans la journée le bruit s’était répandu, comme d’ailleurs les jours précédents que les Allemands avaient introduit 10 tonnes de cheddite (3) dans les souterrains du Sénat pour le faire sauter. La radio aurait même prévenu le public de cette menace cette après-midi. En tous cas, le soir, la plupart des concierges du quartier du Luxembourg ont été alertés. Chez les Lagarenne en particulier, rue Madame, la plupart des gens ont passé la nuit à la cave. C’est cette nuit que Madame Moreux (4) ayant entendu cet avertissement à la T.S.F. ou du moins ayant compris qu’on allait bombarder le Sénat a alerté son fils qui me téléphone à 2 ou 3 heures du matin. Je lui promets d’aller chercher sa mère demain matin et de la cantonner dans l’hôtel à coté de chez nous (5). J’ai su aussi par Lagarenne que ce même jour et d’ailleurs la veille aussi un médecin capitaine allemand était venu à l’Hôtel-Dieu (6) pour échanger contre des blessés allemands un nombre égal de détenus politiques. Officier très correct parait-il, mais il a semblé, à Lagarenne, persuadé que leurs blessés étaient menacés de fusillade. Il a été surpris de voir ces blessés allemands brancardés soigneusement par nos secouristes et nos infirmiers. Comme de très nombreux Allemands, blessés très légèrement ou épargnés, s’étaient réfugiés à l’Hôtel-Dieu, Lagarenne suggère au Directeur de ne pas les garder et de les envoyer prisonniers à la Préfecture. Devant l’hésitation du Directeur, il va lui même à la Préfecture avec son adjoint Prunel, et jusqu’au Chef de Cabinet du Préfet pour provoquer cet ordre. Pendant qu’il est là, on apporte un télégramme parachuté annonçant l’approche des tanks Leclerc et une bataille de chars du coté de l’Haÿ-les-Roses.
(1) Je ne l’ai pas retrouvé (Claire). (2) Le Corre, Millet et Dupas, amis d’internat, habitaient près de la gare de Lyon. (3) Explosif. (4) Belle-mère de Marthe ; son fils Jean-Charles, mari de Marthe, était ami de lycée de Charles. Ils habitaient avenue Matignon alors que Madame Moreux mère habitait 15, rue Garancière face à l’entrée du Sénat. (5) Hôtel des Grands-Hommes, hôtel du Panthéon. (6) Lagarenne y était radiologue.
Vendredi 25 août
Dès 6 heures ou 7 heures du matin un roulement presque continu nous arrive dans le demi-sommeil. Les chars américains ! C’est Denise, partie pour la queue au pain, qui vient les annoncer vers 7 h 30. Ils passent rue Saint-Jacques. Denise y court, puis Marie-Claire. Je m’habille en hâte. Il y a encore peu de monde à cette heure. Ils défilent rue Saint-Jacques. Très bon ordre, très belles tenues. Acclamations. Ce sont des Français. Tanks, petites voitures sur chenilles ou sur roues. Le défilé est lent, coupé d’arrêts. Embrassades aux arrêts, et déjà des cigarettes, des boîtes de conserve. Retournons avec Marie-Claire pour aller à la maison chercher la caméra (1).
Rue d’Ulm, au fond le Panthéon
A peine tournons-nous le coin de la rue Soufflot qu’éclate une fusillade, probablement les Allemands tirent du Sénat. Bientôt la rue Soufflot se vide, tout à l’heure si animée. Denise qui était restée devant Louis-le-Grand nous dira plus tard que les premiers coups de feu sont venus de la jolie petite coupole vert-de-gris qui coiffe une tourelle de la Sorbonne au coin de la rue Cujas et qu’on appelle l’Observatoire de la Sorbonne. Riposte abondante et désordonnée des chars américains, des mitrailleuses et même du canon. Affolement de la foule. Le défilé reprend avec de nombreux arrêts. Les femmes et les enfants et les hommes autour des chars et je t’embrasse, et je t’embrasse… Les hommes sur les chars enlèvent leurs casques qui gênent les contacts, les remettent, les enlèvent. Denise reçoit une boîte de conserve. Je laisse la caméra à Marie-Claire. Promis une visite à Bon Secours. Je remonte à bicyclette la colonne des chars. Au boulevard Port-Royal ceux que je rencontre semblent venus des Gobelins. Plus loin, d’autres montent par l’avenue d’Orléans. Rues pavoisées, battements de mains, fleurs, embrassades. A Bon Secours, très entouré par les mères. Exaltées, quelques unes déplorent la clôture qui leur interdit d’assister à telle fête. Émoi à la porte de Bon Secours. Du bout de la rue des Plantes, des coups de feu partent de la maison d’angle. D’autres coups de feu ont été tirés, on dit du clocher de l’église sur la place d’Alésia. Dans la journée on arrêtera et on fusillera une femme de 75 ans, derrière laquelle se camouflaient des tireurs. Par la rue du Château et le boulevard Pasteur pour aller voir, 26 avenue de Tourville, une malade à qui j’ai promis secours. Le 26 est l’avant dernière maison de l’avenue, près de l’École Militaire. Sans aucune idée que les combats avaient commencé j’arrive derrière Saint-François-Xavier. Les chars occupent le boulevard des Invalides, en position contre l’École Militaire et contre la caserne de Latour-Maubourg. Au moment où j’arrive, le général Leclerc vient de passer. La foule entoure les chars. Au loin pourtant les tanks tirent à coups de canon. Les mitrailleuses allemandes ripostent. Il est inconcevable de voir la foule circuler au milieu des chars en bataille ! Des rafales de mitrailleuses allemandes arrivent par ces avenues, pourtant les accès des carrefours de l’avenue Duquesne et de l’avenue de Breteuil sont gardés de ce que je comprends.
Lire l’article : L’Ecole Militaire
Les chars français attaquent, postés boulevard des Invalides (en réserve), avenue de Villars, place Vauban, avenue de Tourville. Ils attaquent surtout la caserne Latour-Maubourg; l’École Militaire a été attaquée par le Champ-de-Mars et la Motte-Piquet. Je quitte la bataille avant que Latour-Maubourg qui sera le premier à se rendre ne se soit rendu. Il est tard, l’attaque du Sénat ne saurait tarder et j’ai promis d’aller extirper Madame Moreux. Madame Moreux habite la rue Garancière, le 15. La rue aboutit sur l’aile droite du Sénat. C’est la dernière maison de la rue (2). Hier quand je suis allé voir Madame Moreux, des sentinelles faisaient les cent pas le long de la rue de Vaugirard devant les barrages de ronce qui terminent la rue Garancière sur la rue de Vaugirard. Des Invalides à Saint-Sulpice, puis derrière Saint-Sulpice, je remonte la rue Garancière déserte. Silence complet du Sénat. Je passe bien dans l’axe de la rue, Croix-Rouge sur ma bicyclette tenue à la main. Fenêtres du Sénat entièrement déshabitées, vitres cassées. Rien ne bouge. Madame Moreux est prête. Les concierges ne sont avertis de rien. Je leur annonce l’attaque imminente du Sénat. Elle se déclenche dès que nous sommes sortis, mitrailleuses et canons. Au coin de la rue Saint-Sulpice et de la rue de Seine un groupe de gens nous arrête : des rafales de balles passent à chaque instant paraît il, rue de Seine. Il n’y a pourtant pas large à traverser et Madame Moreux est impavide. J’hésite. « Après tout » disent les gens « si vous voulez vous faire casser la gueule… » Je recule. Nous revenons sur nos pas et descendons par la rue Mabillon et la rue du Four sur le boulevard Saint-Germain. Des chars, des tanks et naturellement la foule. Des agents barrent le croisement du boulevard Saint-Germain et de la rue de Seine. Reflux par la rue de Buci. Arrêt de nouveau sur la rue de Seine qui là encore est en pleine vue du Sénat. Des gens reculent, des gens traversent. Mais quoi ? Faudra-t-il aller passer jusque sur le quai ? Madame Moreux garde l’impassibilité de l’innocence. Je lance le cortège. Quelques pas après la traversée des balles viennent encore frapper la maison de l’angle de la rue de Buci et de la rue de Seine. Nous débouchons carrefour de l’Odéon. Au bas de la rue de l’Odéon, des soldats couchés derrière une levée de sacs à terre surveillent, fusil à l’épaule, les sorties du Sénat. Cette fois Madame Moreux se rend compte de la guerre. Au débouché de la rue de l’École-de-Médecine sur le Saint-Michel, de nouveaux chars et qui tirent. Nouvelle hésitation devant la traversée. Mais quoi ? Mieux eut valu alors laisser Madame Moreux chez elle que de rester dans la rue avec nos sacs et nos bicyclettes ! On passe mais vite. J’ai le temps en traversant de voir la flamme d’un de nos canons. Il est posté au bas de la rue Soufflot et tire sur le Palais du Luxembourg, c’est à dire le Sénat. La flamme traverse le boulevard. Nous voici sur « l’autre rive » et tranquilles. De ce que j’ai vu ce jour-là et compris ou appris par la suite, une vingtaine de chars ont attaqué le Luxembourg, postés rue Soufflot, boulevard Saint-Michel, rue de Vaugirard, rue de Fleurus et du coté sans doute aussi de l’Observatoire.
Lire l’article : La prise du Sénat
Tous les petits blockhaus dont les Allemands avaient fortifié le pourtour du jardin ont été écrasés, il semble, à bout portant par les canons des tanks. Mais je n’ai su ces détails que plus tard. Ce jour-là, rentrés à la maison nous sommes restés de midi à cinq heures et 1/2 aux fenêtres et dans l’attente. Un canon français était en batterie derrière un masque de sacs à terre près de la mairie, en haut de la rue Soufflot. On entendait tirer les tanks du Saint-Michel. Les Allemands ripostaient soit à coup de mitrailleuses et de fusils soit à petits obus. Tirant dans l’axe de la rue Soufflot leurs projectiles arrivaient en pleine façade du Panthéon, éclatant la pierre, rebondissant quelques fois en arrière, sans aucun danger pour nous, retirés très en dehors du champ de tir et toutes fenêtres ouvertes ; sans grand danger non plus pour les artilleurs et les agents de la mairie, les projectiles passant au dessus d’eux. De temps en temps un agent, se glissant derrière la jetée de sacs à terre, tirait un coup de fusil en direction du Sénat et déclenchait une riposte. Tiraillades et ripostes ont duré jusque vers 5 heures et 1/2. Le canon juste sur la place n’a guère tiré que 4 ou 5 coups. Le feu de la pièce, le bruit du départ : Marie Claire sursaute. Un peu plus tard et pendant encore la bataille, un photographe range les agents autour du tireur, organise un simulacre de la charge du tir de la pièce. C’est dire la tranquillité du poste. Enfin, petit à petit, après quelques coups isolés et espacés tout s’apaise. Des curieux s’engagent dans la rue Soufflot, encore retenus par les agents du poste. Ils me retiennent aussi sous prétexte de balles perdues possibles. Mais, par derrière la mairie et par la rue Saint-Jacques, j’arrive à la rue Soufflot où beaucoup de monde circule librement. La rue de Médicis est libre. Une foule est déjà devant le Sénat. Un char allemand armé d’un 105 reste devant la grille face à l’Odéon, déjà entouré, assailli, ascensionné par toute une vermine.
"Clôture annuelle" annonce la pancarte accrochée sur le char (photographie Musée de la Résistance en ligne)
Devant l’entrée du Sénat on finit de descendre le drapeau à Croix Gammée. cinq ou six tanks américains devant la porte, noyés par la foule qui commence à s’amasser. Des soldats, des FFI pénètrent dans le Palais, dans les jardins, ressortent des fusils, des armes, des casques, des uniformes. Je monte sur un char. La foule attend des prisonniers et d’avance les insulte. Je n’en ai point vu, sinon des voitures d’ambulance emmenant des blessés. L’aile gauche du Sénat, coté Odéon, est très abîmée la façade seulement maculée d’obus. C’est bien fini. Le dernier nid de résistance allemande est tombé. On dit que c’est le lycée Montaigne qui a résisté le dernier. La foule circule librement, ramasse les débris d’obus, les morceaux de planches et de bois, arrache quelques débris du tank allemand. Les plus malins enroulent les fils téléphoniques qui pendent des fenêtres du Sénat, des réverbères de la place, des saillies de la pierre. La nuit commence. La guerre de Paris est terminée. Quelques coups de feu isolés dans les heures qui suivent ne font que souligner le silence et la paix du soir.
(1) Caméra Pathé-Baby, films 9mm noir et blanc. (2) En ces temps-là il n’y avait pas encore eu de rénovation, l’arche actuelle n’existait pas.
Samedi 26 août
La nuit de vendredi a été (autant que je me rappelle, j’écris ceci le 28) assez calme. Quelques coups de fusils isolés. Au loin le canon. Je pars faire avenue de Tourville la visite que la bataille d’hier a empêchée. Les rues sont pleines de curieux. Les chars américains sont rangés dans la rue, beaucoup sur les trottoirs, entourés de femmes, d’hommes, d’enfants. Familiarité avec les monstres, sur le dos, sur les roues, sur les canons de qui les enfants montent. Les hommes s’intéressent à la technique du char, les femmes demandent des Camels. Au coin de l’avenue de Tourville un officier d’artillerie raconte ses aventures, accoudé à la voiturette américaine (1). Boulevard du Montparnasse les hommes font déjà la toilette de leur éléphant au milieu du concours des curieux. Après ma visite avenue de Tourville, je vais voir l’École Militaire. Fenêtres éventrées, façade maculée par les obus et les balles. A droite de la porte principale un fronton soutenu par deux grosses colonnes : l’une a été complètement brisée par un obus qui, derrière, a défoncé le mur. Pendant que je m’en vais, un remous des curieux : un civil, révolver au poing, suit un Allemand prisonnier, les mains à la nuque. Il vient de l’extraire des débris. Il l’emmène à travers le Champ-de-Mars. La foule court après, cependant et heureusement à un peu de distance. Les injures habituelles « Le salaud ! Tuez-le ! Je vais lui faire son affaire… » Les Invalides, j’en ai un poids de moins sur le cœur, sont sans une égratignure. Derrière les canons du 1er Empire, les chars américains s’appesantissent sur leurs chenilles. Le long des murs des fossés les hommes, torse nu, font leur toilette. Je vais jusque chez les Lavenir (2). Marguerite me raconte cette histoire, plus belle qu’un antique, de ses amis Turbill : le fils de Madame T. arrêté (l’an dernier je crois) par la Gestapo. Disparition. Démarches. Intrigues. Le père finit par savoir son fils dans une prison de Compagne. Il va, étudie les lieux, les protections. Pour le délivrer une fenêtre à barreaux doit être ouverte entre deux rondes de sentinelles et sans bruit. Il rentre chez lui et pendant x jours s’exerce au maniement de lames sur un barreau. Sa femme est dans la cuisine, lui, dans une pièce éloignée. Sa femme écoute le bruit de la lime. Il s’exerce jusqu’à ce que sa femme ait pu lui dire « on n’entend plus rien ». Il retourne alors avec un « copain sûr » à Compagne, organise les préparatifs secondaires pour la fuite et le camouflage de son fils. Puis une nuit se glisse jusqu’à la fenêtre de son fils, entre les deux rondes, lime un barreau. Le jeune homme, assez mince, arrive à passer. Mais dans la même cellule un autre homme jeune et condamné à être fusillé un jour prochain. Il supplie qu’on le délivre. Le père doit mettre d’abord son fils en sûreté avant l’arrivée de la ronde. L’autre : « Quand votre fils sera en lieu sûr, vous allez m’abandonner, je le sais ». Monsieur T. donne sa parole d’officier. Il met son fils en sûreté et il revient délivrer le prisonnier, lui donne 15.000 francs pour pouvoir se débrouiller et retourne à son fils sauvé. Il n’a plus jamais entendu parler (jusqu’à présent) du prisonnier sauvé. Retour à midi à la maison. Dîner avec Madame Moreux, notre hôte encore pour cette journée, et avec Bessi (3) et sa fiancée. Nappe basque, bicolore depuis longtemps oubliée, Serrigny inoubliable et Passe-tout-grain inévitable. Le déjeuner se prolonge. Les filles s’impatientent.
Entouré des membres du Conseil national de la Résistance le général de Gaulle entame une descente triomphale des Champs-Elysées
Les journaux, la TSF, ont annoncé que de Gaulle vient à l’Étoile saluer le Soldat Inconnu, descendrait les Champs-Élysées, s’arrêterait un instant à la Concorde, suivrait le rue de Rivoli, serait reçu à l’Hôtel de Ville et enfin viendrait entendre un Te Deum solennel à Notre-Dame. J’incline à rester à la maison mais je ne peux refuser cette fête à l’exaltation des filles, de Denise surtout. Impossible de les laisser partir seules dans la foule qui est à présumer. Je préférais au moins le Te Deum à Notre-Dame, Jacqueline aussi, mais les filles sont enragées par le défilé. Et Bessi qui ne s’en va pas. Les filles en deviennent impolies. Jacqueline pousse ses invités dehors. Madame Moreux, son sac, ses mitaines, son chapeau, ralentit le départ. Heureusement elle vient de téléphoner à son fils qui nous annonce que des places nous sont gardées au 5ème étage, sur un balcon de la rue de Rivoli, près de la Concorde. Nous partons, traversons les jardins des Tuileries, arrivons place Jeanne-d’Arc. Il y a une haie de curieux, le long de la rue de Rivoli. Elle n’est pas très dense, elle est maintenue par des civils armés FFI et quelques agents. Nous nous décidons presque à rester tellement ce rideau de foule est mince et permet une vue facile de la chaussée. Pourtant une éclaircie dans le rideau nous invite à traverser. Marie-Claire descend de la grille des Tuileries où elle était déjà montée, et nous voilà de l’autre coté de la rue jusqu’au 240. Au 240 (rue de Rivoli) au 6ème étage – bel appartement – Jean-Charles et Marthe, des hôtes gracieux, le fils du docteur Carvalho Jean-Hervé, quelques dames et au balcon une vue splendide sur Paris et à nos pieds la foule de la rue de Rivoli et surtout celle de la Concorde. Des délégations remontent encore vers la Concorde. Un négro enrubanné et encocardé remonte seul, pitre, entre les deux haies. Un remous. De la Concorde jaillissent sur des motocyclettes étincelantes, des agents gantés de blanc jusqu’aux coudes. Elles encadrent une voiture découverte difficile à remarquer, que beaucoup de gens n’ont pas vue. De Gaulle est assis au fond ; un homme en civil est à sa droite ; y avait il quelqu’un à sa gauche ? Il est en kaki, bien conforme à la photo publiée dans les journaux. Il salue la main au képi. Sur le devant de la voiture, un autre général (est-ce Leclerc ?) est entre le chauffeur et un autre militaire.
Ont pris place dans la voiture : à l’arrière le général de Gaulle et Alexandre Parodi, délégué général du CFLN (Comité français de libération nationale) en zone occupée ; à l’avant au centre le général Koenig, commandant en chef des FFI et Claude Guy, l’aide de camp du général de Gaulle (que l’on voit accoudé à la portière en uniforme d’aviateur).
La voiture passe rapidement, suivie de 5 ou 6 tanks en désordre, dépassés par des voitures plus ou moins civiles, des side-cars, des voitures de presse de cinéma, sans ordre, se cornant les unes les autres, se bousculant presque ; quelques petites voiturettes américaines en désordre portent mêlés sur leurs ailes, sur leurs banquettes, sur leurs (illisible) des civils, des femmes, des poules (4). Derrière les voitures passent des groupes, avec des banderoles ; un des groupes « Les Femmes de Clichy » auxquelles s’agrègent des femmes sorties de la foule. Passent aussi des « anciens combattants ». Passa aussi une voiture type Simca, sur le toit de la voiturette une jeune femme tient le "drapeau-rouge-faucille-et-marteau". Derrière la voiture, sur le pare-choc une autre femme tient le poing levé. Silence dans la foule et peu de réponses au poing levé ; puis la foule s’agrège aux délégations ou les suit et la confusion est complète.
Place de la Concorde à l'entrée de la rue de Rivoli
Des coups de feu éclatent il nous semble du côté de la statue de Jeanne d’Arc. La foule se couche ou se disperse à travers les jardins, court de part et d’autre. Nous reculons du balcon, des coups de fusils et de mitrailleuses partent de la rue vers les toits et les balcons supérieurs où nous sommes. Une balle passe dans le cabinet de toilette, à coté de nous. A-t-elle été tirée depuis l’hôtel Continental dont nous ne sommes séparés que par la rue Rouget-de-l’Isle ? Est-ce déjà une balle tirée d’en bas ? Tout à coup, reculé au fond avec le reste de la société, je vois arriver dans le salon, rampant vers le balcon, un fusil à la main, un civil d’allure douteuse. Je le prends pour un fusilleur des toits et j’esquisse le mouvement de tomber sur lui. Jacqueline me retient : c’est un FFI. Plus tard elle s’est demandé si c’était un vrai ou un faux. En tous cas d’autres FFI arrivent. Ils ont enfoncé la porte du 3ème et envahissent la maison; confusion extrême. La rue tire encore aux fenêtres. Un char se met en batterie dans les Tuileries et commence à tirer aussi contre la maison. Les ordres de cesser le feu montent et descendent la cage d’escalier où nous sommes réfugiés sur les marches. Au bout d’une heure le calme revient. Les invités filent. Jacqueline très énervée précipite aussi notre départ et à travers la Concorde pourtant pacifiée, précipite notre course. J’ai à peine le temps de vérifier les dégâts du Ministère de la Marine. La petite façade de retrait sur la rue de Rivoli est très éventrée.
Un lion de pierre de la balustrade des Tuileries gît à terre près de la bouche du métro. Le boulevard Saint-Germain est calme. Marthe et Jean-Charles qui se sont attardés après nous, nous téléphoneront que la mitraillade a repris une heure après et qu’ils ont eu peine et danger à sortir et à regagner l’avenue Matignon. Les bruits et les journaux préciseront le soir et le lendemain que les mitraillades ont sévi tout le long du parcours, à l’Étoile, aux Champs-Élysées, à l’Hôtel de Ville et surtout sur le Parvis et jusque dans Notre-Dame. Sur le Parvis, la foule ne sachant où fuir s’est couchée à plat ventre dans le désordre, l’affolement, la terreur qu’on peut imaginer. On raconte que 2000 chaussures ont été retrouvées sur le Parvis. Monsieur Séjourné (5), le serrurier notre voisin, nous dit qu’il n’a pu suffire à aller ouvrir les maisons de tous ceux qui ayant perdu sacs et clefs lui demandaient l’ouverture de leur appartement. Une cérémonie de « purification » ou de « réconciliation » a dû, le lendemain, purifier Notre-Dame du sang qui y avait été versé. On discute beaucoup pour savoir si de Gaulle a fait lui aussi ou non un plat ventre à l’entrée de Notre Dame. Un officier allemand aurait tiré de l’intérieur de Notre-Dame. On parle aussi d’une femme qui tenait sur le bras gauche un enfant. Sa main droite passée sous le derrière de l’enfant et armée d’un révolver tirait sur la foule. Elle est arrêtée. Elle demande grâce au nom de ses quatre enfants. Un blessé que j’ai vu lundi matin à la Gare de Lyon et qui se trouvait sur la place m’assure que quatre internes et deux infirmières tirant de l’Hôtel-Dieu ont été arrêtés et qu’il a vu l’un d’eux basculer une mitrailleuse par un vasistas de la maternité. Dans les premiers jours de la bataille j’avais pris pour un mythe ces tireurs de toit. Dans tout drame populaire il faut un rôle de traître. Le Boche n’y suffisait pas. Le tireur de toit répondait mieux à l’aspiration populaire. La perquisition faite le mercredi 23 août dans les étages supérieurs et les chambres de bonne de la maison m’avaient confirmé dans cette conception des Tireurs des Toits.
Rue de Rivoli, la foule tente de se mettre à l'abri
Depuis des précisions telles m’ont été données, les faits ont été si fréquents qu’il n’y a guère lieu de douter que non seulement il existe des tireurs isolés soit sur les toits, soit dans la foule, mais que encore ils forment une sorte de 5ème colonne commandée et reliée suivant un réseau peut-être lâche et discontinu mais organisé. A l’intérieur de l’Hôpital Cochin (6) deux infirmières ont été ainsi blessées. L’enquête a révélé un tireur sur les terrasses de l’Hôtel Médical Maheux (?). C’était un Allemand et un tireur dans une des maisons incluses dans la muraille de Cochin – c’était un milicien que la concierge avait omis de déclarer. Quénu m’a rapporté ces faits. Nous avons nous-mêmes entendu bien souvent des coups isolés et en particulier une véritable mitraillade pendant l’incendie de la Halle aux Vins (7). Le samedi quand je sortais de Bon Secours on tirait de l’extrémité de la rue des Plantes et de la place d’Alésia. On a arrêté et fusillé une vieille femme qui accoudée à son balcon, les mains pendantes sur le balcon, masquait deux tireurs. Les fusils passaient sous ses bras et tiraient sur la foule. Naturellement une véritable psychose s’est greffée là-dessus ; on a vu des tireurs partout sur les toits. C’est ainsi que notre maison 15 place du Panthéon a été cernée et fouillée le 23 août, que le balcon où nous étions rue de Rivoli a été pris pour cible le jour du défilé. Bessi m’a rapporté une histoire analogue du coté de la rue Duroc, rue Bertrand au 9ème étage. Ils jouaient au bridge. Fait irruption un locataire du bas ou un passant : « On tire de votre terrasse ». On lui fait visiter l’appartement. A ce moment deux balles traversent la pièce et le plafond, puis quelques minutes après, fusils et mitrailleuses au poing arrivent, menaçants, deux ou trois agents. Tout s’explique : eux-mêmes sur l’indication du locataire avaient tiré sur la terrasse dénoncée comme suspecte. Cent autres histoires pareilles. Je pense aux épidémies de « piqueurs » dans le métro en temps de paix : pendant des fois huit jours, quinze jours, toutes les dames en métro avaient leurs robes ou leurs sacs percés par des maniaques. La publicité engendrait des imitateurs, créait une contagion, déformant les faits. Il reste que les fusilleurs des toits existent. Les réactions créent plus de mal que n’en font les tireurs. C’est ainsi que rue de Rivoli nous avons étés tirés au canon. De même le vendredi à 8 heures quand les troupes Leclerc passaient rue Saint-Jacques, elles ont tiré à coups de canon contre la petite coupole verte de l’Observatoire de la Sorbonne d’où on leur avait tiré dessus (peut être deux Japonais). Quelqu’un m’a dit que c’était Jean Nohain qui avait tiré le canon. Après ce défilé mouvementé, et un peu fatigués, nous rentrons à la maison.
(1) Sans doute une jeep qu’on découvrait. (2) Famille amie ; ils avaient une pharmacie et habitaient avenue de la Motte-Picquet. (3) Interne de Charles à Notre-Dame-de-Bon-Secours. (4) Jargon familial destiné à faire secret pour les enfants. Il y avait les « poules » femmes de mauvaise vie et les P.D.L, « poules de luxe » aussi de mauvaise vie mais dans le luxe… (5) Les Séjourné avaient leur serrurerie qui existe toujours rue des Fossés-Saint-Jacques ; leur fille Jacqueline était en classe au lycée Fénelon ; amie de Denise. (6) Où Charles Jacquelin avait une consultation de gastro à la « Consultation externe » avec une porte ouvrant directement sur la rue Saint-Jacques ; elle faisait partie du service de Chirurgie du professeur Jean Quenu, ami d’internat de Charles. (7) Qui se trouvait à l’époque sur un quadrilatère fait par le quai Saint-Bernard, la rue des Fossés-Saint-Jacques, la rue Linnée et vers la rue Cuvier.
Dimanche 27 août
Hier soir samedi, retour du défilé, dîner très tard vers 9 heures et 1/2. L’électricité fait une courte apparition (1). Nous attendons qu’elle revienne. De guerre lasse on se résout à se coucher. Les petites lampes « Pigeon » (2), la lampe électrique. Il est 11 heures et 1/2. Réveil à minuit. Un bruit d’avion très bas au dessus de nous. « Des Anglais » (3) dit le Père. Jacqueline s’inquiète. La D.C.A. se met à tirer. Il faut bien accepter que ce soient des Allemands, malgré mon sommeil. Marie-Claire arrive dans la chambre et s’étend dans le lit, puis Denise. Avions et D.C.A. redoublent. Aux fenêtres, des fusées rouges montent dans le ciel comme des feux d’artifice ; elles partent de derrière Sainte-Barbe, derrière l’École de droit, derrière la mairie. Leurs trajectoires courbes convergent au dessus du Panthéon et de la maison et derrière nous. Elles montent assez vite, se suivant à courte distance, puis ralentissent leurs courses, puis immobilisent leurs niveaux en petits lampions rouges dans le ciel. Quelques fois, venant de derrière Sainte-Barbe un globe blanc, rouge, plus rapide traverse le ciel. Obus traçant ? La place du Panthéon s’illumine.
Les dégâts rue des Francs-Bourgeois (Film INA). Lire les articles : Le Bombardement du 26 août et Eliane la rescapée
La lumière vient de derrière nous et à droite. Pourtant une lumière en étoile au dessus du lycée Henri IV, est-ce une fusée allemande, participe à l’illumination. Jacqueline est déjà habillée et nous presse de descendre à la cave. A la fenêtre de la salle à manger avec Denise. Fracas ou plutôt souffle violent, assourdissant les oreilles, battant les portes et les fenêtres, un bruit de déchirement, de vitres brisées. Descente (4) pendant laquelle souffle encore violemment une bombe. À la cave tous les locataires, des bougies. On regarde le plafond où courent des gabariages de briques, pauvre protection. Pendant la descente à la cave, le signal d’alerte avait retenti, assez faiblement pour que très peu de personnes l’ait entendu. Nous remontons quelques uns au bout d’un instant. Un incendie considérable et tout proche illumine le ciel derrière le Panthéon et le lycée Henri IV. Nous le situons après quelques discussions à la Halle aux Vins (5), ce qui nous sera confirmé un peu plus tard. Pendant que Jacqueline monte téléphoner à droite et à gauche, je descends avec Denise jusqu’à la rue Cardinal-Lemoine. Illumination de toute la place par l’incendie des alcools de la Halle aux Vins. Le dôme du Panthéon resplendit. Des bombes seraient tombées rue Rollin. Notre promenade dimanche après-midi nous montrera en effet le désastre rue Monge, au bas de la rue Rollin : les quatre immeubles d’angle, des deux cotés de la rue Monge, soufflés, déshabillés, vidés et en partie renversés. L’alerte finie, retour à la maison et quelques heures plus tard, nouveaux bruits d’avion, nouveaux tirs de D.C.A., nouvelle descente en robe de chambre, mais cette fois peu sûrs de notre cave, dans la cave voisine au 13 (Place du Panthéon). Le reste de la nuit est calme. Pourtant l’incendie de la Halle aux Vins, à la première alerte, des mitraillades. Les journaux ajoutent aujourd’hui que non seulement il a été tiré sur la foule mais qu’encore les tuyaux des pompiers ont été coupés à plusieurs reprises. Les journaux donnent aussi des renseignements sur les fusées rouges que je signale plus haut. Jacqueline de la fenêtre avait vu devant la mairie s’arrêter une voiture, une femme en descendre et, du groupe, jaillir une de ces fusées. Pour en avoir vu plus de cinquante sortir de derrière l’École de droit et la mairie, je les avais attribuées à un signal ou à des balles traçantes lancées par nos chars. Les journaux les attribuent aujourd’hui à des signaux tirés par les francs tireurs ennemis. Aujourd’hui dimanche pas d’incident. Matinée calme. L’après-midi nous allons aux points de chute, à la rue Monge où le désastre atteint une douzaine de maisons. Des débris les gens extraient quelques objets familiers, une poêle, un morceau de linoléum, une casserole, un poste de TSF. Chacun va ranger un peu plus loin dans une maison voisine ces débris pour en reconstituer une sorte de misérable foyer personnel. Rue Ortolan une maison a été complètement éventrée sur toute sa largeur. Depuis la rue Saint-Médard la maison apparaît comme en coupe : au 4ème une salle à manger apparaît avec encore ses fauteuils, son buffet. Le soir visite aux Michaud (6) dans le calme presque rustique de la Muette, ombre, silence, jardins. Le combat a à peine touché la région. Michaud me dit que le vendredi, jour d’arrivée des troupes françaises, de nombreux Allemands occupaient encore les maisons de Neuilly. Un kilo de beurre. En allant chez les Michaud je suis dérivé au voisinage de la Chambre des Députés. On cerne la Chambre et tout le pâté des maisons voisines. Les gardes sont aux aguets à chaque coin de rue. Les autres sur les toits pour la chasse aux fusilleurs.
(1) Pendant cette période il y avait du courant électrique pendant une heure vers midi et parfois une demi-heure le soir. (2) Lampes à carburant solide, je crois, dans lesquelles on ajoutait de l’eau qui donnait une lumière très faible mais plus stable qu’une flamme de bougie (qu’on ne trouvait d’ailleurs plus dans Paris). (3) L’aviation anglaise avait réputation de voler plus bas et donc d’être plus précise dans ses lâchers de bombes que l’aviation américaine qui, lâchant de plus haut, était plus largement meurtrière. (4) Descente par l’escalier de service sur l’arrière de la maison vers la cave. (5) La Faculté de Jussieu occupe actuellement ce grand territoire de l’ancienne Halle aux vins. (6) Michaud : ami de Charles Jacquelin, Bourguignon.
Sous la fenêtre de l’appartement place du Panthéon. Le M7 Priest « Saturne » du 64ème RADB, commandé par le maréchal des logis Daniel.
Lundi 28 août
Journée calme. Le soir à 9 heures 30, de derrière l’École de droit montent quatre fusées rouges, sans aucune détonation, sans aucun bruit. A 10 heures 30, pendant que l’électricité est revenue, Denise et moi écoutons les informations, Jacqueline l’oreille toujours aux aguets signale un moteur d’avion. En effet le bruit se rapproche et bientôt sept ou huit fusées toujours du même endroit montent du ciel. Descente précipitée au 13. De la rue où nous faisons les cent pas, sous un petit vent d’automne et de nuit, on entend le canon au nord de Paris, on voit les lueurs à chaque départ. Pas d’avion ; pas de bombe. Remontée à minuit et 1/2. Nuit calme.
Mardi 29 août
Une infirmière à la gare de Lyon a vu elle aussi d’un remblai de chemin de fer monter hier soir quelques fusées. Depuis hier déjà, comme les autres ponts, le Pont d’Austerlitz est gardé par les canons alliés.
Mercredi 30 août
Nuit calme. Cependant depuis deux jours et deux nuits le canon ne cesse de tonner au nord et au nord-est de Paris. Même cette nuit, des coups assez rapprochés. Vu ce matin Truffert (1) et pris le champagne à la salle de garde de Bon Secours, avec les internes. Un d’eux, Bartolino, ancien officier de carrière et entré dans la médecine après 1940, fait partie comme officier des FFI. Il confirme que le mouvement déclenché le Samedi 19 août l’a été par les Communistes seuls, et beaucoup trop tôt. Les vraies forces FFI ont été obligées de suivre, mais n’auraient été vraiment alertées et mises en mouvement que le mardi 22. Les éléments communistes ont agi constamment en initiative privée ; personne ne comprend le défaut, le décousu, la faiblesse et l’inefficacité de la réaction allemande qui aurait pu être terrible contre ce mouvement prématuré. Il eut suffi de quelques avions déversant quelques bombes sur le centre principal de la Résistance, à la Préfecture de Police pour anéantir le noyau de la Résistance. Plus tard, au moment des barricades, des tanks allemands patrouilleurs passaient devant les barricades sans les démolir. A côté de cette faiblesse, des atrocités. Bartolino qui s’est battu autour du Donjon et du Bois de Vincennes confirme ce qu’on dit les journaux.
Identification des corps trouvés dans les fosses communes. Lire l'article Fusillades à Vincennes
Des agents et des FFI pris pendant l’émeute de Paris ont été martyrisés, dents arrachées, yeux crevés, ongles arrachés et ont dû eux même creuser leur tombe. Bartolino tenait le renseignement d’un évadé. Renseignements analogues donnés par une maraîchère de Saint-Denis et de Stains. Avant hier les Allemands qui avaient quitté Stains ont fait un retour offensif, repris la ville, aligné les hommes en otages, tailladé les joues, écrasé les corps sous des tanks. Pour en revenir au mouvement FFI, on dit que les Américains sont étonnés de son action. Il est dans notre politique, dans notre intérêt de gonfler le plus possible cette action. Il n’est pas douteux qu’il y avait également un intérêt important à exalter le moral français, à le pousser dans le feu de la guerre et de l’héroïsme, à le relever de cette sorte d’affaissement et de sentiment d’infériorité que les publications sur notre décadence, sur nos « décombres », avaient enfoncé encore plus avant. Quand à l’efficacité véritable, militaire, du mouvement au moins à Paris, et au moins dans ces journées, elle est plus douteuse. Le mouvement ne s’est déclenché et n’a pu se déclencher, et encore s’est-il déclenché prématurément, qu’après le départ de presque toutes les forces allemandes de Paris, le jeudi soir. Il ne restait que quelques îlots dont peut-être même le départ était prévu pour les jours suivants. L’attaque FFI a eu facilement, ou plus ou moins facilement, raison le vendredi et le samedi d’éléments isolés, de voitures et de camions traversant Paris dans l’ignorance des événements, de groupes surpris par l’émeute inattendue. Elle a même dépensé un héroïsme et une ingéniosité extraordinaire à s’emparer de dépôts d’armes, voire de quelques tanks, mais elle ne pouvait rien et n’a d’ailleurs pour ainsi dire rien tenté contre les îlots de résistance où s’était fortifié tout ce qui restait de la garnison allemande. Les choses auraient pu rester longtemps en état. Les FFI organisaient une administration dans les quartiers où les Allemands ne les assaillaient pas; les Allemands retirés dans certains quartiers qu’ils contrôlaient absolument comme les Champs-Élysées et dans leurs îlots de résistance. Quelques fusillades et coups de mains FFI lésaient et agaçaient les Allemands. Quelques expéditions punitives allemandes avec chars et mitrailleuses n’arrivaient qu’à quelques dégâts matériels sans réduire ce réseau imprenable, insaisissable, fuyant, reconstitué que les FFI tendaient sur Paris. L’absence d’une grande réaction allemande reste un mystère. À défaut de cette réaction ils restaient maîtres, en groupe, de faire ce qu’ils voulaient. Ce sont les chars de l’Armée Leclerc qui ont brisé leurs résistances en 1/2 journée, quelques chars de l’Armée Leclerc. Il est probable que ce n’eut pas été plus long ni plus difficile sans l’émeute des jours précédents. Ce qui a le plus aidé l’Armée Leclerc c’est la complicité unanime de la foule, la sécurité absolue où se trouvaient hommes et matériel dans toutes les rues de Paris, en dehors des quelques points tenus par les Allemands. Cette complicité, cet état d’esprit n’eussent peut-être pas été les mêmes si l’esprit de la Résistance n’avait pas été éveillé, maintenu, relevé par les organisations clandestines. Une certaine sagesse populaire à laquelle on n’ose pas toujours faire crédit, tant on a abusé d’elle et tant elle même s’est abusée, vaut peut-être cependant dans un grand drame mieux que certaine raison raisonnante. Elle s’exprime par une réaction, dépourvue peut-être d’argument, mais orientée par un puissant tropisme vers l’issue et la lumière. Il faut choisir, dit Valéry, entre réagir et comprendre et c’est se retirer de l’existence que de se vouer à comprendre. L’ensemble français a réagi. Ceux qui ont voulu trop comprendre ont sûrement mal réagi, et peut-être en outre n’ont pas compris. Cette sorte de raison raisonnante s’exerce avec plus de profit sur les choses du passé que dans les drames en mouvement. Les médecins n’ignorent pas que l’action du système nerveux central de l’écorce grise a un pouvoir de dérèglement, d’inhibition même sur des réflexes vitaux issus de la moelle. Dans un certain acte vital essentiel, une bonne moelle passe la plus subtile des cervelles. Hier après-midi l’Armée américaine a défilé dans Paris.
Prévenus trop tard et rendus méfiants par le défilé de dimanche, nous sommes restés à la maison, à la grande consternation de Denise. Photographies ce matin dans les journaux. Pas encore vu en privé d’Américain. De Le Corre et de Bartolino (2) qui les ont pratiqués, j’apprends que les Américains sont peu amis des Anglais, les accusant de profiter de tout et de ne rien faire par eux-mêmes (sauf pourtant le débarquement), que les Français de l’Armée Leclerc sont peu amis des Américains qui ont tant tardé à leur donner des armes, et beaucoup plus des Anglais qui ont soutenu de Gaulle, que la cote française a beaucoup remonté auprès des Américains depuis qu’ils connaissent et on vu l’action de la Résistance ce qui suffirait déjà à justifier et la Résistance et les battements autour de la Résistance.
(1) Truffert : médecin ORL de Notre-Dame-de-Bon-Secours. (2) Le Corre et Bartolino : de Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Dimanche 17 septembre
Réunion FFI à la Faculté de Médecine. Renseignements importants sur l’insurrection parisienne. Grande réunion au grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine. Elle aurait été annoncée par un seul journal. Je l’ai apprise par Boyer, par Bessi, elle m’est confirmée par Joanny (1). Assez difficile de savoir quelle sorte de réunion, qui l’organise et pour qui. Le matin à 10 heures je m’y rends avec Bessi. Les deux trottoirs de la rue de l’École de Médecine sont garnis de FFI en bleu, l’arme au pied. Dans le grand hall, une haie de FFI, on passe librement. L’amphithéâtre est déjà plein. J’y reconnais Ogliastri, Coquelin, Damon, Delahaye, Gibert, la monstrueuse figure de Blechman, plus monstrueuse encore que sa pâleur, Aurousseau, Obertin, Strauss, Boyer. Plus tard pendant les discours, Quénu apparaîtra au plus haut rang, laissant tomber sur l’orateur un œil et une bouche dégoûtés. Autour de la table, aux fauteuils ou aux chaises réservés, Debré, Leibovici, Leveuf, Merle d’ Aubigné, Moutier et, un peu plus tard, le ministre de l’Air Tillon, un colonel tout jeune avec le brassard, grave, de figure assez sympathique – c’est le Colonel Rol, accompagné de deux officiers d’ordonnance – Pasteur Valéry-Radot et d’autres que je ne connais pas. Tiffenau, en l’absence de Baudouin retenu ailleurs, ouvre la séance. De ce discours semble résulter que la réunion est offerte par le Front National des Médecins (2) aux FFI de la région parisienne.
 Le premier qui prend la parole après Tiffenau, est Casanova, un Corse qui a joué un rôle important dans la libération de la Corse et dans celle de Paris. C’est de l’insurrection de Paris qu’il nous parle, avec une parole d’abord un peu lente et difficile, puis progressivement avec vigueur, avec feu, avec violence. Voici ce que j’ai retenu de son discours :
Le premier qui prend la parole après Tiffenau, est Casanova, un Corse qui a joué un rôle important dans la libération de la Corse et dans celle de Paris. C’est de l’insurrection de Paris qu’il nous parle, avec une parole d’abord un peu lente et difficile, puis progressivement avec vigueur, avec feu, avec violence. Voici ce que j’ai retenu de son discours :
-que les jours qui ont précédé l’émeute ouverte, ils ont par petits groupes à travers la ville, arraché des armes aux Allemands.
-qu’au début de l’émeute ils n’étaient pas 400 hommes armés. On frémit de penser qu’ils ont pu déclencher ce mouvement avec 400 hommes mal armés contre la puissance et le matériel allemands. Mais ce chiffre de 400 ne doit correspondre qu’à son groupe particulier, car les agents en civil qui participaient à la révolte me semblent avoir été beaucoup plus nombreux.
-que ce n’est pas eux, ou au moins toujours son groupe, qui ont décrété le couvre-feu à 14 heures le samedi 19 août.
-qu’au contraire leur tactique a toujours été de laisser à Paris sa figure normale, gens dans les rues, fenêtres ouvertes, de façon d’abord à ménager la surprise (les Allemands, les camions isolés, les groupes venant des environs entreront ainsi dans un Paris d’aspect pacifique où il sera facile par surprise de les attaquer) ; d’autre part pour que les insurgés soient répartis dans la foule, sans distinction, de sorte que les Allemands ne puissent concentrer leur action contre eux et ne sachent d’un passant ou d’un groupe si ce sont des insurgés ou des indifférents.
-que la fameuse trêve du dimanche a bien en effet suivi une tractation avec le commandement allemand ; que c’est le commandement allemand qui l’aurait sollicitée, pris de peur devant cette ville en insurrection où ils ne savaient où et comment appliquer la défense et la répression, et pour permettre aux débris de leur 7° armée de passer la Seine sur les seuls ponts qui restaient, ceux de Paris. Mais cette tractation, ce « gentleman agrément », eux-mêmes (?) s’y sont opposés, ils ont refusé que la tractation les englobe. Ça s’est passé entre gentlemen pour qui ils n’ont que mépris. L’honneur militaire ne peut être envisagé quand il s’agit des Allemands, qui ne sont que « des chiens et des bandits ».
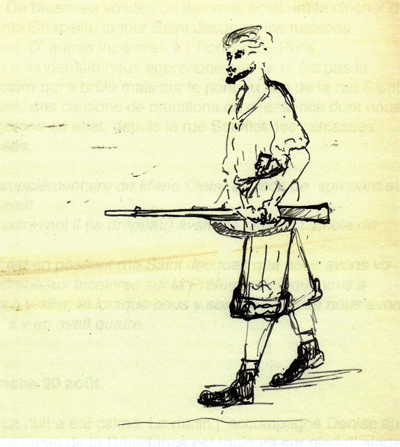 Je m’explique mieux, après ces explications la confusion qui a accompagné et surtout suivi le dimanche après midi, l’annonce d’une trêve et le « cessez-le-feu » claironné place du Panthéon. Tout un groupe ne s’est donc pas associé à cette trêve. Aux combattants de la Préfecture qui étaient d’autant plus partisans de cette trêve, qu’ils étaient presque à bout de munitions, ils ont répondu que la Préfecture importait peu, que les combattants n’avaient qu’à se répandre comme eux dans les rues pour continuer et gonfler l’insurrection. Il apparaît bien ainsi que même dans ce mouvement insurrectionnel local de Paris l’unité était loin d’être faite et que beaucoup d’insurgés ont compris le risque effroyable que pouvait faire courir à Paris la répression allemande dans l’état de désarmement où se trouvaient les insurgés. Mais les Allemands non plus n’ont pas compris. Ils ont eu peur de la ville, des pavés, de chaque maison, de chaque habitant. On ne peut expliquer qu’ainsi la timidité et l’incohérence de leur réaction. Le petit groupe d’insurgés dont parle Casanova, et qui semblent bien tous du même parti, a, au contraire payé d’audace.
Je m’explique mieux, après ces explications la confusion qui a accompagné et surtout suivi le dimanche après midi, l’annonce d’une trêve et le « cessez-le-feu » claironné place du Panthéon. Tout un groupe ne s’est donc pas associé à cette trêve. Aux combattants de la Préfecture qui étaient d’autant plus partisans de cette trêve, qu’ils étaient presque à bout de munitions, ils ont répondu que la Préfecture importait peu, que les combattants n’avaient qu’à se répandre comme eux dans les rues pour continuer et gonfler l’insurrection. Il apparaît bien ainsi que même dans ce mouvement insurrectionnel local de Paris l’unité était loin d’être faite et que beaucoup d’insurgés ont compris le risque effroyable que pouvait faire courir à Paris la répression allemande dans l’état de désarmement où se trouvaient les insurgés. Mais les Allemands non plus n’ont pas compris. Ils ont eu peur de la ville, des pavés, de chaque maison, de chaque habitant. On ne peut expliquer qu’ainsi la timidité et l’incohérence de leur réaction. Le petit groupe d’insurgés dont parle Casanova, et qui semblent bien tous du même parti, a, au contraire payé d’audace.
-c’est d’eux qu’est venu l’ordre des barricades, qui a ainsi malgré les temporisateurs (les traîtres dira Casanova), prolongé, renouvelé, multiplié l’insurrection, mais surtout qui y a associé l’ensemble de la population parisienne. A partir de ce moment, dit Casanova, les Allemands ont eu de plus en plus peur. Ils n’osaient même plus sortir pour des démonstrations rapides (pourtant l’attaque de la mairie du Panthéon est du mardi, l’attaque du Grand-Palais le mercredi).
-que le jeudi soir, avant de connaître l’arrivée des Américains, ils étaient prêts à fortifier encore l’insurrection, qu’ils s’étaient entendus avec le Syndicat des Paveurs pour créer des pièges à tanks. Aussi, loin de s’amenuiser, l’insurrection gagnait de jour en jour en nombre et en moyens techniques.
J’ai retenu en particulier de ce discours, malgré les appels à l’union et l’assurance formulée d’une action commune, que l’action avait été entreprise sans unité, sans moyen, qu’il y avait mésentente entre les groupes, que la peur et l’incompréhension allemandes nous ont sauvés d’un risque énorme et, plus encore l’arrivée de l’Armée Leclerc dont il n’a pas été question dans le discours de Casanova. Mais il y avait dans son discours un tel feu, une telle passion que beaucoup de ces remarques ne venaient qu’à la réflexion et que pendant le discours on était entraîné avec lui dans ce mouvement héroïque et insensé, contre lequel toutes les raisons du monde valent peu, puisqu’il a réussi. Il a réussi à ne pas entraîner notre massacre, à ne pas retenir les Allemands, à recevoir l’Armée Leclerc dans une ville presque libre, et, surtout gonflé par les voix de la renommée et de la légende qui s’en sont si vite emparé, à nous créer un titre difficile à discuter sur le plan international.
 Le deuxième orateur est le ministre de l’air Tillon : haute stature, visage simple et énergique ; rôle général, recrutement, vie, sacrifices des FFI. Il nous rapporte en particulier le martyre de ce jeune communiste breton, condamné à mort, je crois pour sabotage de voies ferrées. Emmené au poteau d’exécution par un groupe d’Allemands commandé par un officier, il se dégage brusquement de ses liens, saute sur l’officier et lui plonge sa propre dague dans la poitrine. Il fut cloué sur le cercueil de l’officier allemand. Pour faire pendant à ce martyre communiste, une histoire de jeune catholique, fusillé aussi, mais histoire qui est loin d’avoir la dureté et la densité de l’autre. Il insiste sur cette union en soulignant la présence à ses côtés de camarades sortis et d’autres rangs et d’autres milieux ou partis que le sien, lui est communiste. Figurent en effet contre la toile de fond de l’amphithéâtre, un moine au froc marron de capucin et Pasteur Valéry-Radot.
Le deuxième orateur est le ministre de l’air Tillon : haute stature, visage simple et énergique ; rôle général, recrutement, vie, sacrifices des FFI. Il nous rapporte en particulier le martyre de ce jeune communiste breton, condamné à mort, je crois pour sabotage de voies ferrées. Emmené au poteau d’exécution par un groupe d’Allemands commandé par un officier, il se dégage brusquement de ses liens, saute sur l’officier et lui plonge sa propre dague dans la poitrine. Il fut cloué sur le cercueil de l’officier allemand. Pour faire pendant à ce martyre communiste, une histoire de jeune catholique, fusillé aussi, mais histoire qui est loin d’avoir la dureté et la densité de l’autre. Il insiste sur cette union en soulignant la présence à ses côtés de camarades sortis et d’autres rangs et d’autres milieux ou partis que le sien, lui est communiste. Figurent en effet contre la toile de fond de l’amphithéâtre, un moine au froc marron de capucin et Pasteur Valéry-Radot.
 Le troisième orateur, dont je n’ai pas compris le nom (*) est « Président du Comité d’Action Militaire ». Petit bonhomme, apparence d’employé, de figure rageuse, accoudé pendant toute la séance de façon négligée sur un coin de la table, et seul de toute la salle fumant cigarettes sur cigarettes. Tout son discours est sur l’organisation de la nouvelle armée. Il n’y est pas question des formations de Leclerc. Tout est centré sur les FFI et surtout la conservation en unité distincte des FFI. Il refuse l’amalgame au sein d’une grande armée nationale. Il refuse aussi la participation des anciens officiers de l’Armée française, dont plusieurs se seraient présentés pour servir, au Colonel Rol. Il les appelle assez plaisamment « officiers de naphtaline » pour ce qu’ils n’ont songé à leur costume militaire conservé alors dans les armoires, que depuis la Libération. Il cite aussi avec admiration ce capitaine FFI commandant un groupe de 150 hommes à qui l’armée (??) a demandé sa collaboration avec 30 de ses hommes et qui a répondu « tous avec moi ou personne ». Il insiste sur le caractère populaire, sur la discipline populaire, sur le mode d’élection populaire des chefs, que doit conserver cette nouvelle armée. Il faut en somme qu’elle reste l’expression et l’instrument des hommes qui l’ont recrutée, entraînée, et menée à la victoire, et qui pourraient avoir encore à s’en servir. Bien entendu le communisme qui a mené le combat ne peut être comparé à ces généraux victorieux, tant redoutés des Républiques de Rome à Paris, et qui gardaient leurs troupes triomphantes pour leur usage et leur intérêt politique. Il s’agirait plutôt ici de conserver les fruits de la victoire commune, comme l’a compris l’assistance bourgeoise qui remplissait l’amphithéâtre.
Le troisième orateur, dont je n’ai pas compris le nom (*) est « Président du Comité d’Action Militaire ». Petit bonhomme, apparence d’employé, de figure rageuse, accoudé pendant toute la séance de façon négligée sur un coin de la table, et seul de toute la salle fumant cigarettes sur cigarettes. Tout son discours est sur l’organisation de la nouvelle armée. Il n’y est pas question des formations de Leclerc. Tout est centré sur les FFI et surtout la conservation en unité distincte des FFI. Il refuse l’amalgame au sein d’une grande armée nationale. Il refuse aussi la participation des anciens officiers de l’Armée française, dont plusieurs se seraient présentés pour servir, au Colonel Rol. Il les appelle assez plaisamment « officiers de naphtaline » pour ce qu’ils n’ont songé à leur costume militaire conservé alors dans les armoires, que depuis la Libération. Il cite aussi avec admiration ce capitaine FFI commandant un groupe de 150 hommes à qui l’armée (??) a demandé sa collaboration avec 30 de ses hommes et qui a répondu « tous avec moi ou personne ». Il insiste sur le caractère populaire, sur la discipline populaire, sur le mode d’élection populaire des chefs, que doit conserver cette nouvelle armée. Il faut en somme qu’elle reste l’expression et l’instrument des hommes qui l’ont recrutée, entraînée, et menée à la victoire, et qui pourraient avoir encore à s’en servir. Bien entendu le communisme qui a mené le combat ne peut être comparé à ces généraux victorieux, tant redoutés des Républiques de Rome à Paris, et qui gardaient leurs troupes triomphantes pour leur usage et leur intérêt politique. Il s’agirait plutôt ici de conserver les fruits de la victoire commune, comme l’a compris l’assistance bourgeoise qui remplissait l’amphithéâtre.
(*) Il s'agit très vraisemblablement de Pierre Villon.
Pasteur Valéry-Radot n’a pas pris la parole à cette séance, mais son nom prononcé a été acclamé. Aucun autre médecin n’a d’ailleurs pris la parole en dehors du président Tiffenau.
(1) Joanny : médecin, proche de Charles Jacquelin. (2) Bien sûr aucun rapport avec le Front national actuel ! (Claire).
La page précédente porte le n° 37, celle-ci le n° 39. Est-ce une erreur de numérotation ou une page manque-t-elle ? La page n° 39 est la dernière de cette « Chronique de la Libération de Paris » par mon père.
29 septembre 1944
Toujours pas d’électricité qu’une heure le soir de 10 à 11 heures, d’où l’ennui d’écrire (1). Vu Colleson en consultation samedi matin. Très amer sur les fifis (sic). Il habite le quartier de la République. Au moment de l’insurrection le maire du X° aurait signé une trêve particulière avec la garnison de la caserne de la République. Une bande du XX° serait descendue de Belleville pour rompre cette trêve. J’ai beau lui remontrer le bénéfice moral que nous avons du point de vue international tiré de ce mouvement, du sang versé, de la fierté reconquise, il ne veut y voir qu’un mouvement sans aucune efficacité. Les Allemands étaient prêts à se rendre aux forces régulières américaines sans coup férir ou en tous cas sans dommage pour la population parisienne et pour Paris. L’action insurrectionnelle n’a fait que troubler cette convention, risqué de faire écraser Paris et en tous cas provoqué la mort de plus de mille personnes et la destruction de millions de richesses. Vu également J. CH chez Laffont. Son ami H., officier de la Résistance dans le Lot, parmi d’autres récits lui a fait les deux suivants :
A un moment ils prennent la décision de délivrer Cahors. Organisation excellente, très militaire de l’attaque, moral très combatif ; les points importants autour de Cahors sont organisés, occupés. Tout est prêt quand le jour de l’attaque ils voient arriver une troupe qui après hésitation se trouve une troupe amie. Les Allemands ont évacué Cahors la veille ou le matin ! Le même H. rapporte que leur formation était composée de différents partis, droite, communiste, radicaux. Il fait un vif éloge des communistes tant moral que militaire et de l’union qui a toujours lié les membres de la troupe. Il est décidé après la Libération, que dans le Comité d’Organisation Administrative, toutes les tendances devront être représentées. En réalité les Communistes seuls rassemblent et procèdent à la formation du Comité en désignant à tout de rôle un de leurs membres, dont l’un représente la tendance radicale, l’autre les démocrates chrétiens, l’autre les libéraux, etc. Ainsi tout le Comité est communiste. A la vérité, les journaux laissent entrevoir que dès maintenant la lutte communiste est engagée. Beaucoup de gens prennent peur, d’où un certain air de tristesse, non tant dans les rues, mais dans les maisons, dans les conversations. Beaucoup de Fifis patriotes se retirent des organisations où sont submergés par les communistes. Ainsi le docteur Parat, ainsi notre interne Bartolino.
Les mairies, au moins celle du V°, sont gardées par des hommes sans uniforme, à tenue débraillée, la cigarette au coin de la lèvre, les mains aux poches, la mitrailleuse ou le fusil en bandoulière. Chaque homme qui entre à la mairie est fouillé par ces gardiens. Fouille à la vérité rapide et surtout symbolique mais faite sans tenue et sans correction. Protestations de quelques uns.
Fin du manuscrit du docteur Charles Jacquelin
(1) Charles Jacquelin aimait à écrire, faire ses lettres et ses comptes-rendus médicaux quand sa nichée était endormie. L’absence de lumière l’a sûrement empêché de le faire ce qui explique sans doute l’écart entre la date précédente (17 septembre) et ce jour.