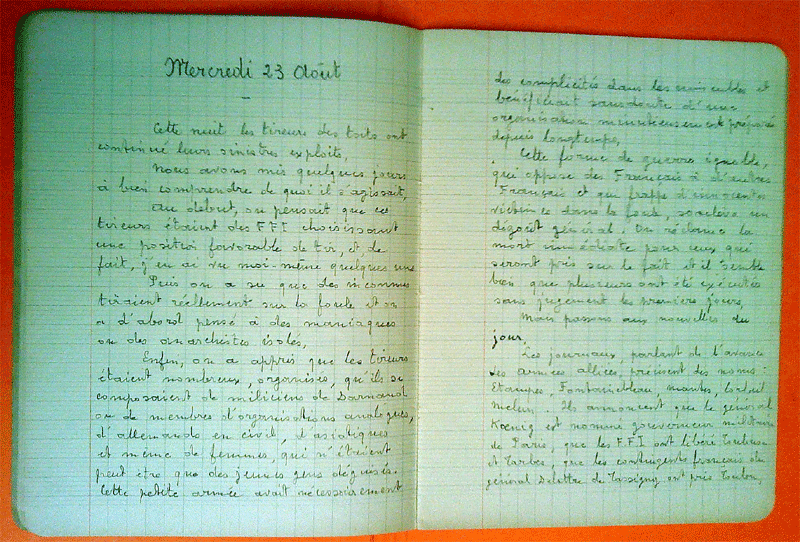André Auvinet, avocat de 56 ans, travaille au service juridique de la SNCF rue Saint-Lazare et demeure 3, rue Palatine près de l’église Saint-Sulpice. Parisien ordinaire mais fin observateur, il a laissé à sa fille Geneviève un petit cahier de cinquante-cinq pages sur lequel il a noté tout ce qu’il a vu pendant ses pérégrinations à travers la capitale en ébullition. Son petit-fils Bruno Dufaÿ, archéologue et historien, l’a retranscrit et annoté en le comparant aux divers témoignages parus sur le sujet. Merci à lui de bien vouloir nous faire partager ce témoignage inédit d’un « Piéton de Paris » du 18 au 28 août 1944. Les photos sont tirées des ouvrages cités dans la page Bibliographie.
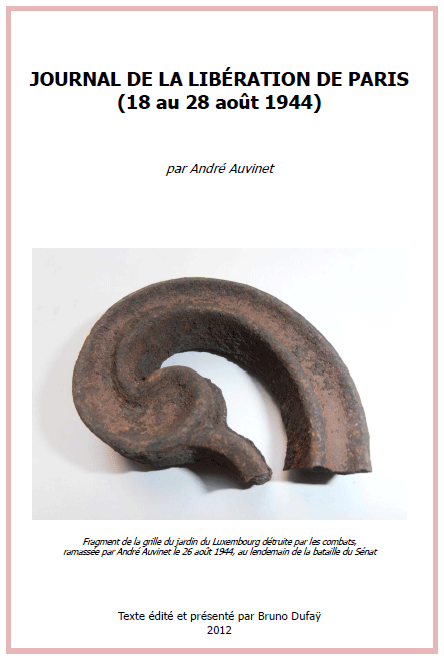
INTRODUCTION
(par Bruno Dufaÿ)
Le texte qui suit est la transcription d'un manuscrit rédigé par André Auvinet, mon grand-père maternel, que sa fille Geneviève (ma mère) a conservé après son décès en 1980[1]. Il s'agit d'un journal quotidien qui raconte la libération de Paris, du 18 au 28 août 1944. Il est écrit recto-verso à l'encre noire, à la plume[2], sur un petit cahier d'écolier à grands carreaux, à la couverture verte, de la marque Cortambert. Il comporte cinquante-cinq pages, soit presque la totalité du cahier[3].
Il est difficile d’apprécier si ce texte est, ou non, le résultat d'une élaboration à partir de notes et de brouillons. La question se pose car il subsiste deux lignes d'un tel éventuel brouillon. En tête d'une page de papier vert de mauvaise qualité pliée en deux se trouve écrite, à la plume, la mention « + de la rue Saint-Lazare », et dessous, au crayon noir « Le métro est fermé depuis ». Sachant qu'André travaillait rue Saint-Lazare, et qu'en août 1944 le métro a été en grève quelques temps, il est clair que ces deux membres de phrase ont trait à la libération de Paris. De fait, ce papier a été conservé parce que sa fille Geneviève, alors âgée de seize ans, y raconte un épisode lié à la bataille du Sénat (voir ci-dessous à la journée du 25 août). Le texte du cahier comporte très peu de ratures, mais André savait rédiger. Il était avocat, avait écrit des poèmes et des projets de roman dans sa jeunesse, et les lettres de lui qui sont conservées montrent un style excellent et sans ratures. Il se peut donc qu'il se soit astreint à une rédaction quotidienne, sans doute à partir de notes prises sur le vif et de la lecture de la presse. C'est en tous cas ainsi qu'il présente le texte, dont certaines journées finissent par une question sur le lendemain. Mais c'est aussi un procédé rhétorique classique, et la question n'est donc pas tranchée.
Quoi qu'il en soit, il a été écrit pendant ou très peu après les événements. Il est évident qu'il s'agit d'un témoignage direct et non d'une réminiscence littéraire tardive. Le ton en est simple et direct, celui d'un témoin oculaire. Il représente la perception d'un Parisien ordinaire, mais curieux, dont la préoccupation première était de protéger les siens. S'il ne fait pas de politique, c'est néanmoins un observateur avisé qui comprend vite les subtilités de la situation, et dont les analyses sont souvent très pertinentes, comme le prouve la comparaison avec d'autres témoignages, plus élaborés et plus historiques.
Il a paru notamment intéressant de confronter ce témoignage avec celui écrit par Ferdinand Dupuy, secrétaire-chef du commissariat central du 6ème arrondissement de Paris, très peu de temps après les événements, puisqu'il a reçu le visa du contrôle militaire le 13 octobre 1944 (il fut publié en 1945)[4]. Il couvre la période du 12 au 25 août.
Ce commissariat était (est toujours) situé place Saint-Sulpice, à 150 mètres du domicile d'André, qui habitait au premier étage, 3, rue Palatine, le long de l'église Saint-Sulpice. Il était visible de ses fenêtres, et il dit y être plusieurs fois allé aux nouvelles ; il a pu rencontrer Dupuy. En tous cas, les deux textes ont bien des similitudes, ce qui indique qu'André n'a pas affabulé. Un certain nombre de phrases même se font écho, ce qui peut s'expliquer par l'expérience des mêmes événements.
La différence principale est que Dupuy a écrit un ouvrage de propagande gaulliste à grand tirage, alors qu'André n'écrivait que pour se souvenir. Il n'y a guère d’analyse politique chez André, juste la haine de l'occupant et l'admiration pour les résistants, les alliés et le général de Gaulle, en tant que libérateurs. D'autre part, Dupuy était attaché à son commissariat, où il a même passé une partie de ses nuits, alors qu'André, profitant de la grève de l'administration où il travaillait (la SNCF), s'est beaucoup promené dans le quartier latin et sa périphérie. Il a donc vu des choses que Dupuy n'a pas vues, et réciproquement.
le cahier manuscrit d'André Auvinet ouvert à la page du 23 août, photo Bruno Dufaÿ
VENDREDI 18 AOUT[5]
À 6 h 1/2, je rentre du bureau à pied[6], le métro ne fonctionnant plus du tout depuis le 12 août à 15 h[7].
Je passe par les Boulevards. Ils présentent ce soir un aspect étrange qu'on ne reverra sans doute jamais.
Des milliers de cyclistes pédalent rapidement, par rang de quatre et plus, sur les deux côtés de la chaussée. Au milieu, dans les deux sens et sans ordre apparent, défilent à grande vitesse des camions et véhicules divers allemands camouflés de feuillage, des chenilles[,] des tanks, quelques canons. Il passe aussi des camions parisiens, bourrés de banlieusards debout qui, faute de trains, utilisent ce moyen de transport de fortune pour rentrer chez eux.
Comme les agents de police sont en grève[8], il n'y a pas de service de circulation et c'est sur la chaussée une mer mouvante, inextricable, sans coupure, impossible à traverser.
Sur les trottoirs, la foule habituelle des piétons regarde d'un air goguenard et satisfait l'exode allemand[9], commencé depuis plusieurs jours, mais qui n'a jamais été aussi massif et précipité que ce soir.
Il y a de la poudre dans l'air. Hier soir, au cours d'une échauffourée, les Allemands ont incendié à la grenade deux immeubles du Boulevard Saint-Denis, l'un au coin de la rue Saint-Denis, l'autre au coin de la rue de Cléry. Ce matin, ce sont les magasins Dufayel qui flambaient boulevard Barbès[10].
Personne ne parle. Les Parisiens gardent leurs pensées pour eux, les Allemands, peu exubérants d'ordinaire, sont encore plus calmes aujourd'hui.
Cet immense silence qui plane sur la foule est impressionnant. Il me rappelle le recueillement précurseur de la soirée du 6 février 1934, il y a dix ans[11].
On sent que tous, Français et Allemands, sont dans l'attente anxieuse de graves événements.
Que verrons-nous demain ?
SAMEDI 19 AOUT
Je vais au bureau, à pied bien entendu, pour savoir si la grève patriotique des chemins de fer, déjà effective hier dans les services actifs, affecte ce matin nos services sédentaires[12].
Peu de travailleurs dans la rue à cause du manque de transports et de la semaine anglaise[13].
Sur mon trajet, moins de véhicules allemands. Ceux qui subsistent se dirigent dans tous les sens et non seulement vers le Nord.
Quelques Allemands mangent encore tranquillement au "Soldatsheim" (sic) du restaurant Marguery[14], mais le "Soldatenkino" du Rex[15] et celui de Parisiana[16] paraissent bien fermés pour toujours.
On déménage fiévreusement dans tous les hôtels réservés aux Allemands[17].
Au bureau, nous apprenons que sont démentis tous les bruits relatifs à Paris "ville ouverte" ou "ville sanitaire" et que l'avance alliée se poursuit de manière satisfaisante en Normandie.
Nous faisons décidément grève la semaine prochaine, comme tous les services publics, y compris – ce qui ne manque pas d'étonner tout le monde – le service des Pompes funèbres[18].
Je dois cependant, pour ma part, assurer l'audience du Conseil de Prud'hommes, en la Cité[19], lundi à 1 h, parce que je suis celui dont le domicile est le plus rapproché de ce Tribunal.
À 11 h 1/2 je rentre, toujours à pied, avec mon collègue Tricot et nous nous séparons au Pont des Arts après avoir traversé un Paris peu agité.
Mais rue de Seine, tout change. La vieille rue est en grande effervescence et présente presque un aspect d'émeute. Je pressens que la Résistance est entrée ou va entrer en action et quelques mots saisis au vol me confirment dans cette opinion.
Cela devient évident boulevard Saint-Germain. Dans la foule bruyante passent des petites autos dont les occupants portent le brassard tricolore avec la croix de Lorraine des F.F.I.[20] Quelques cyclistes affairés arborent les couleurs tricolores à leur béret.
Une jeune fille très émue dit en passant que les Allemands viennent de mitrailler la foule rue du Bac.
Des passants disent qu'on se bat place de la Concorde et sur les quais, d'autres disent qu'on pavoise au Quartier Latin, principalement rue Soufflot.
Passent sur le boulevard Saint-Germain, venant de la rue du Bac, quelques camions et side-cars allemands qui donnent l'impression de sortir d'une bagarre. Les occupants, debout, l'air farouche et résolu, braquent revolvers et mitraillettes sur la foule.
Les curieux, dont je suis, s'arrêtent un moment instant, mais il ne se passe rien pour le moment.
Quelques minutes après, un grand remous de gens qui courent et je vois déboucher, venant de la rue de Tournon, plusieurs escouades d'Allemands, des S.S. dit-on, qui occupent rapidement le trottoir nord du Boulevard et installent des mitrailleuses.
Ils s'étendent jusqu'à Saint-Germain des Prés et semblent vouloir encercler le quartier. Aussi, je rentre à la maison, pour le cas où Yette[21] ou les enfants[22] seraient dehors.
Je trouve à la porte d'entrée Ginou[23] qui a déjà essuyé rue de Fleurus un coup de feu tiré on ne sait d'où. Heureusement elle n'a pas peur et elle se disposait à aller chercher Yette qui fait la queue à la boulangerie, au coin de la rue Princesse.
J'y vais moi-même. Yette avait bien vu le manège des S.S., mais elle était alors dans les premiers rangs et tenait à garder sa place.
Nous rentrons sans encombre et déjeunons en présumant que la journée sera chaude.
En effet, les coups de feu commencent vite à crépiter un peu partout. Nous nous mettons aux fenêtres et y passons le plus clair de notre temps, peut-être imprudemment.
Des voitures de F.F.I. passent sous nos yeux, revolver en main. Au coin de la rue Garancière, un occupant descend, inspecte et remonte. Dès que l'auto disparaît, on entend une salve, tirée on ne sait d'où.
Nous voyons arrêter un homme accusé, paraît-il, de dénonciations. Il est mené sous bonne escorte à la mairie. Il n'en mène pas large.
Je vois des gens qui lisent une affiche sur la place. J'y vais, et il s'agit seulement d'un avis indiquant que, ce soir, le couvre-feu sera à 9 heures au lieu de 1 heure du matin, ce qui ne surprend personne.
Des quantités de F.F.I. sortent de la mairie, où ils ont une permanence[24]. Ils sillonnent la place Saint-Sulpice, armés de pistolets ou de fusils.
Ils disent que la bagarre est générale dans Paris et la banlieue et conseillent aux habitants de rentrer chez eux.
Ils disent aussi que la garnison du Sénat, composée de soldats de la "Lutwaffe" (sic) a été remplacée par des S.S., ce que je n'ai pu contrôler[25].
Je rentre et peu après, c'est la mitrailleuse qui se fait entendre. Une jeune fille tombe, place Saint-Sulpice, entre la fontaine et la mairie. On la transporte sur un brancard à la permanence des F.F.I. Quelques instants après, le Docteur Peyre, qui partait pour lui donner des soins, nous apprend qu'elle a été tuée sur le coup.
De nos fenêtres, nous voyons aussi, ou plutôt nous devinons quelques arrestations.
C'est d'ailleurs tout ce que nous verrons directement dans notre rue paisible et retirée, mais quelle fanfare de coups de feu à droite, à gauche, devant, derrière, en l'air, à terre, partout !
La soirée est un peu plus calme, nous allons pouvoir nous coucher et nous le faisons en même temps que M. le Curé, qui déserte son presbytère trop rapproché du Luxembourg et qui a passé l'après-midi à faire les cents (sic) pas dans la rue avec son fidèle abbé Michel et l'abbé Champenois qui arbore un brassard croix-rouge[26].
En fermant les persiennes dans la nuit, Yette entend un bruit de bottes étouffé. Huit S.S. mitraillette sous le bras, longent silencieusement le mur de l'église.
Voilà un voisinage dont on se passerait bien.
DIMANCHE 20 AOUT
Les tirailleurs ont tiraillé toute la nuit. Du moins, on les entendait chaque fois qu'on se réveillait[27].
Passant sur la place avant d'aller à la messe, je vois affiché à la mairie, un avis du Colonel Rol[28], Commandant les Forces Françaises de l'Intérieur du "Grand Paris" invitant les F.F.I. de 18 à 50 ans à se considérer comme mobilisés immédiatement. Le nom du Colonel Rol, pseudonyme sans doute[29], était inconnu du public. Quant aux F.F.I., ils se sont mobilisés tout seuls, hier.
Après la messe, à laquelle assistent bon nombre de fidèles[30] une fusillade s'engage rue Garancière, vers la rue de Vaugirard. On dit que des allemands tirent sur le toit du Luxembourg et que les F.F.I. ripostent, des toits également.
Quoi qu'il en soit, le tir est nourri et continu. Les habitants ne peuvent plus rentrer chez eux sans danger et d'aucuns passent par notre maison, puisque les immeubles des deux rues communiquent par les cours.
Nous avertissons les passants qui se dirigent par là, mais, chose curieuse, un petit nombre seulement rebrousse chemin. Beaucoup nous accueillent même en gêneurs et s'en vont délibérément sous les balles. Heureusement personne n'est blessé, du moins sous nos yeux[31].
Avant déjeuner, je vais jusqu'au boulevard Saint-Germain, pour voir. Au bout de la rue Montfaucon, un barrage de F.F.I. empêche de passer dans la direction du Carrefour de l'Odéon. Il paraît que des tireurs, des Japonais (?)[32] et une femme ont tiré toute la nuit des étages supérieurs et ont blessé trois personnes. Les F.F.I. vont leur donner la chasse, mais où sont-ils au juste ?
Après déjeuner, la lutte s'amplifie et on entend beaucoup plus la mitrailleuse et le canon des tanks. Ce sera comme cela jusqu'à 4 heures, heure vers laquelle la fusillade cesse presque entièrement.
Le bruit court qu'une sorte d'armistice local[33], de trêve, aurait été conclu entre la garnison allemande et l'état-major F.F.I.
Je vais aux nouvelles à la mairie[34]. C'est exact, une affiche dactylographiée annonce qu'en vertu de la trêve qui vient d'intervenir, ordre a été donné de cesser le feu jusqu'à l'évacuation des troupes allemandes (dont l'échéance n'est pas fixée)[35]. On dit que des autos avec équipage franco-allemand parcourent les rues et préviennent verbalement la population, mais je n'en rencontre aucune[36].
Je rentre vite porter la bonne nouvelle à la maison. Nos amis Couteau[37] sortent aussitôt, mais ils n'ont pas fait cent pas que des coups de feu éclatent à droite et à gauche[38].
Mieux, comme je suis sorti aussi, je suis immobilisé rue Bonaparte entre la rue du Four et la place Saint-Sulpice. Trois S.S. embusqués place Saint-Germain-des-Prés tirent des coups de fusil qui balayent toute la rue. Ils se cachent au coin des immeubles d'angle, mais on les voit fort bien.
Je rentre dans la loge d'une concierge qui me dit qu'il y a des chefs F.F.I. dans son immeuble et que, pour sa part, elle ne croit pas à la réalité de la trêve.
De fait, on continue à entendre des coups de feu partout tout le long de la soirée. S'agit-il d'isolés, ou d'unités isolées qui n'ont pu être prévenues ?
Nous sommes encore dans l'incertitude quand vient l'heure du couvre-feu.
Vont-ils déguerpir dans la nuit ?
LUNDI 21 AOUT
Ils sont toujours là. La guérilla a persisté cette nuit. Elle dure ce matin[39].
À midi 1/2 je tente d'aller au Conseil de Prud'hommes, bien que le bruit ait couru que tous les édifices publics de la Cité sont fermés.
Rue Danton les F.F.I. dépavent pour construire une barricade. Ils me confirment que les Tribunaux ne siègent pas. Ils empêchent tout le monde de passer, sauf les infirmières de l'Hôtel-Dieu. A deux d'entre elles, ils disent de faire attention place Saint-André-des-Arts où des S.S. sont embusqués et tirent.
Rue Hautefeuille, une barricade est commencée. Rue de l'Ancienne-Comédie, peu après le fameux café Procope, une barricade encore, celle-là en sacs de sable et déjà terminée.
Je rentre et nous entendrons tout le jour le crépitement de la fusillade tantôt nourri, tantôt grêle, très intermittent, avec de grands silences qui durent jusqu'à deux heures.
Dans l'après-midi, j'ai été coincé rue du Vieux-Colombier. Impossible de traverser la rue de Rennes, balayée par des rafales de mitrailleuses. Les S.S. tirent à hauteur de l'entrée de la rue Madame. Les F.F.I. ripostent à hauteur du métro Saint-Sulpice et rue Madame, en face la caserne des pompiers.
Quand j'ai pu rentrer, je vois de la fenêtre que l'escarmouche s'est rapprochée de la Place [Saint-Sulpice]. Un passant qui s'est mis à l'abri derrière un pilier de pierre de la facade (sic) de la mairie où il est insuffisamment protégé, voit tout-à-coup une poussière de pierre volant en éclats, à hauteur de sa poitrine, sous l'action d'une volée de mitraille. D'un bond, il se jette dans la mairie au moment précis où une deuxième rafale arrive. Il a eu chaud.
Le ravitaillement – il faut bien qu'on en parle – nous a préoccupé aujourd'hui. Plus de gaz, plus de chauffage électrique[40], plus de marché, plus de colis, plus de marché noir, rien[41].
Nous n'avons jamais essayé notre poële cuisinière depuis notre entrée dans l'immeuble en 1934 et il nous reste bien peu de charbon[42].
Tout de même la cuisinière marche et nous calculons que nous pouvons tenir une huitaine de jours avec ce qui nous reste de charbon.
En fait nous avons assez de réserves pour tenir ce temps-là et tout ira aussi bien que possible.
Le pain se fait rare. Quelques boulangeries seulement ouvrent, et à des heures inattendues. On ne donne qu'un pain, après une longue queue et quelques fois sous les balles. Les ménagères s'engouffrent dans les maisons quand il y a du danger et la queue se reforme ensuite[43]. Yette n'a pas peur et même un jour elle va rue de Tournon[44].
Cette nuit nous sommes réveillés par une série d'explosions formidables qui remuent nos fenêtres et encore plus les vitraux de l'église. Les Allemands font sauter quelque chose avant de partir et ce n'est pas bien loin.
MARDI 22 AOUT
Surprise agréable ce matin pour les Parisiens : les journaux réapparaissent et cette fois, ils sont bien français.
Ce sont les journaux clandestins de la Résistance qui paraissent au grand jour. Les titres sont nouveaux pour bien des gens. On se bat pour les avoir et celui que je peux atteindre s'appelle "Libération"[45].
Le ravitaillement en nouvelles était ces jours-ci aussi précaire que le ravitaillement en victuailles.
20 minutes de courant électrique par jour, plus de postes émetteurs de T.S.F. à Paris et quand on peut attraper la radio anglaise, c'est pour entendre annoncer que, pour des raisons militaires, les noms de ville en Normandie ne sont pas communiqués.
Le public colporte des nouvelles de la plus haute fantaisie. Le moins qu'on puisse dire est qu'il est en avance de 3 jours sur les événements, prenant ses désirs pour des réalités[46].
J'ai essayé de me documenter auprès des petits gars de la Résistance. Ils ne savent rien de ce qui se passe hors Paris et n'en disent pas plus que les journaux d'aujourd'hui, si peu loquaces.
Par contre, ils savent tout de Paris. Du Sénat à la Cité se déroulent des combats presque ininterrompus qu'ils racontent. C'est par eux que j'ai connaissance des mémorables batailles de la Préfecture, de l'Hôtel de Ville, de la mairie du Ve.
C'est sur leurs indications que je peux suivre au son la marche des patrouilles de tanks qui partent du Sénat et rayonnent rue de Tournon, rue de Seine[47], boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, rue de la Harpe et plus loin. Nous apercevons une colonne de fumée noire de temps en temps et nous devinons qu'un tank brûle à tel endroit.
Le mouvement de la Résistance est diversement apprécié dans le public[48], mais tout le monde rend hommage au grand courage de ces petits gars.
Pour détruire un tank ou un camion allemand, ils jettent dans les roues une bouteille d'essence puis une grenade à main[49].
Ne voulaient-ils pas, hier et aujourd'hui, faire l'assaut du Luxembourg, érigé par les Allemand en véritable forteresse, alors qu'eux sont pauvrement armés de révolvers et de fusils ! Ce n'était pas une vantardise, j'en ai la conviction, et j'imagine que leurs chefs ont dû avoir du mal à les dissuader.
Les pauvres petits gars ont eu des morts et des blessés[50]. Ils disent qu'ils ont plus de prisonniers que les Allemands.
Ce soir le canon tonne, nous sommes bien certains de l'entendre. Jusqu'ici on avait un doute, mais nos oreilles s'exercent au milieu de tous ces bruits : révolvers de tous calibres, fusils de guerre, mitraillettes, mitrailleuses, canons légers et lourds de tank, grenades, explosions.
Le jour de la libération approche.
MERCREDI 23 AOUT
Cette nuit les tireurs des toits ont continué leurs sinistres exploits.
Nous avons mis quelques jours à bien comprendre de quoi il s'agissait.
Au début, on pensait que ces tireurs étaient des F.F.I. choisissant une position favorable de tir, et, de fait, j'en ai vu moi-même quelques-uns.
Puis on a su que des inconnus tiraient réellement sur la foule et on a d'abord pensé à des maniaques ou des anarchistes isolés.
Enfin, on a appris que les tireurs étaient nombreux, organisés, qu'ils se composaient de miliciens de Darnand[51] ou de membres d'organisations analogues, d'Allemands en civil, d'asiatiques et même de femmes, qui n'étaient peut-être que des jeunes gens déguisés. Cette petite armée avait nécessairement des complicités dans les immeubles et bénéficiait sans doute d'une organisation minutieusement préparée depuis longtemps.
Cette forme de guerre ignoble, qui oppose des Français à d'autres Français et qui frappe d'innocentes victimes dans la foule, soulève un dégoût général. On réclame la mort immédiate pour ceux qui seront pris sur le fait et il semble bien que plusieurs ont été exécutés sans jugement les premiers jours[52].
Mais passons aux nouvelles du jour.
Les journaux, parlant de l'avance des armées alliées, précisent des noms : Étampes, Fontainebleau, Mantes, Corbeil, Melun. Ils annoncent que le général Koenig est nommé gouverneur militaire de Paris[53], que les F.F.I. ont libéré Toulouse et Tarbes, que les contingents français du général Delattre (sic) de Tassigny[54] ont pris Toulon.
Ils donnent des détails sur les batailles des rues parisiennes. Quelques engagements ont été sérieux : 30 allemands tués, 50 faits prisonniers dans une seule escarmouche à l'Hôtel de Ville. L'acteur de cinéma Aimos[55] a été tué lors de l'attaque d'un convoi.
De la ville parvient la nouvelle que les Allemands ont incendié le Grand Palais[56].
On dit que les Alliés ont eu la délicate prévenance de décider que des troupes françaises, la division Leclerc, fera la première son entrée à Paris[57].
On dit surtout que cette entrée est certainement pour demain, peut-être même pour ce soir[58].
Dans la soirée, en effet, le bruit roulant du canon s'amplifie et se rapproche et ce bruit pourtant sinistre signifie : espoir pour les Parisiens.
JEUDI 24 AOUT
Grande nouvelle ce matin. La Roumanie capitule. Ceux de ma génération songent à la capitulation de la Bulgarie, en septembre 1918, qui marqua le commencement de la fin[59].
Les journaux annoncent un débarquement des Alliés à Bordeaux[60] et la libération de Marseille et Grenoble[61].
Et ils annoncent surtout qu'une colonne américaine, qui serait forte de 30 000 hommes et 300 chars vient de partir d'Arpajon pour marcher sur Paris[62].
La nouvelle se précise, on dit la division Leclerc à la porte d'Orléans et il ne fait aucun doute que l'arrivée des troupes libératrices est imminente.
Ginou et Marie-Hélène[63] se mettent ensemble à la confection des drapeaux qui pavoiseront nos fenêtres[64] et elles y travaillent d'arrache-pied avec grand enthousiasme, ne se laissant pas rebuter par la minutie des étoiles de la bannière yankee.
Tout Paris attend le crépuscule avec fièvre, tandis que les combats de rue redoublent et se font de plus en plus violents à mesure que les F.F.I., au cours de coups de main heureux, parviennent à améliorer leur armement et à décupler leurs munitions aux dépens des ennemis vaincus.
On se bat partout aujourd'hui et au canon. On signale de vives bagarres au quartier latin, au bois de Boulogne, place Clichy, à la gare de Belleville, à Ménilmontant, boulevard de Courcelles, carrefour Montmartre, aux Gobelins, à la Poste rue du Louvre, près des bains de Seine Deligny, à la mairie du IIIe, etc.
On raconte que 3 étudiants F.F.I. ont réussi l'exploit de capturer seuls un char d'assaut allemand. On dit que le ministère de la marine et l'hôtel Crillon auraient été en partie incendiés[65].
Dans notre quartier, c'est le crépitement habituel. On entend toujours résonner la bataille livrée çà et là aux patrouilles du Sénat composées presque invariablement de deux tanks légers, un tank "Tigre"[66] et un camion de fantassins.
Enfin, le soir tant attendu arrive. Après dîner, nous sommes prévenus que la division Leclerc va être reçue à l'Hôtel de Ville[67]. Nous regardons à la fenêtre les gens qui s'y rendent, mais nous n'y allons pas, pensant qu'avec la foule et l'absence de toute lumière, on ne pourra rien voir[68].
Bientôt, et c'est une grande joie, nous entendons la grande voix des cloches de Notre-Dame. D'autres églises répondent dans tout Paris, tout le monde est ému[69]. Saint-Sulpice sonne avec quelques minutes de retard, tandis que des groupes de jeunes gens et de jeunes filles parcourent les rues en criant "Vive la France"[70].
Nous apercevons les fusées d'un feu d'artifice tiré sans doute place de l'Hôtel de Ville[71]. Les enfants montent au 4e étage, chez Marie-Hélène, pour jouir de ce spectacle qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps.
Et c'est en saluant notre belle délivrance que nous nous préparons à dormir, au son de la "Marseillaise" chantée dans la rue, pendant que les tireurs des toits tirent toujours dans la nuit.
VENDREDI 25 AOUT
Paris est pavoisé copieusement aux couleurs alliées, spectacle oublié, hélas, depuis bien longtemps[72].
La gaîté se lit sur tous les visages et les gens s'interpellent sans se connaître.
Les agents de police reprennent leur service en uniforme, la vue de leur silhouette familière manquait.
Dans les journaux, nous lisons avec intérêt le détail de l'arrivée de la division Leclerc à l'hôtel de Ville et, comme tout le monde aujourd'hui, nous nous inquiétons de savoir où nous pourrons aller, nous aussi, leur souhaiter la bienvenue.
Ils sont boulevard Saint-Germain, c'est M. Couteau qui nous l'annonce et nous partons immédiatement avec sa famille.
De nombreux tanks et camions chargés de nos sympathiques soldats sont en effet stationnés au carrefour Rue du Four – rue de Buci. La foule en délire les entoure, et les acclame. Tout le monde veut s'approcher pour leur parler. Les femmes et les jeunes filles se bousculent pour les embrasser, ce qui paraît leur plaire particulièrement.
On fait échange de menus cadeaux[,] Monique[73] et Marie-Hélène leur offrent des cigarettes, mais ils disent qu'ils en ont plus que nous.
Ils racontent que l'accueil de la population normande ne leur a pas plu énormément et qu'au contraire Paris les fête au-delà de leurs espérances[74]. Il y a d'ailleurs parmi eux un certain nombre de Parisiens pour lesquels le bonheur est double.
Au bout d'un long moment de ce spectacle réconfortant, nous nous disposons à partir. Justement, les tireurs des toits recommencent leurs exploits et leur tir nous escorte jusqu'à la maison[75]. Guy, très intéressé, reste quand même.
Il paraît que vers 2 h l'assaut sera donné au Sénat avec les tanks que nous venons d'acclamer.
Après déjeuner donc, nous attendons les événements lorsque la défense passive passe dans les maisons proches du Luxembourg comme la nôtre pour recommander aux habitants de descendre à la cave[76].
Il fait un temps magnifique, ce qui m'incite à rester sur le banc du jardin où se trouve déjà notre colocataire M. Moinier, commandant de réserve ayant participé à la guerre 14 et à la guerre 39 et qui est très intéressant à écouter au point de vue militaire.
A l'oreille, nous distinguons très bien la marche des tanks Leclerc partis, croyons-nous de la rue de Tournon, qui suivent la rue de Vaugirard et montent la rue Guynemer. Par moments, c'est un sérieux vacarme, le canon se mêle à la mitrailleuse et cela dure des heures.
On vient nous prévenir que la garnison du Sénat dispose de 10 tonnes de dynamite et que si le commandement allemand fait sauter sa forteresse tout le quartier sautera avec[77].
La plupart des locataires restent (sic) dans la cave[78]. Quelques-uns s'en vont chercher refuge dans d'autres quartiers où ils ont une maison amie.
Je doute fort que les Allemands aient 10 tonnes de dynamite et je doute fort qu'ils se fassent sauter. Comme j'hésite néanmoins à cause des enfants, on apprend du dehors qu'un parlementaire français vient d'entrer au Sénat et qu'il est question de reddition.
M. Moinier va aux nouvelles et revient en disant que la garnison allemande veut se rendre à la condition d'avoir à traiter avec des militaires seulement. Or, les F.F.I. émettent le désir d'être représentés aux pourparlers.
Nous attendons, lorsque la défense passive revient dans chaque immeuble pour prévenir les occupants que si les discussions au sujet de la reddition n'aboutissent pas, la division Leclerc va employer l'aviation[79].
Cette fois le danger me paraît plus réel et nous cherchons un moyen pratique de passer la nuit ailleurs, lorsque des passants joyeux nous crient de la rue que la garnison du Sénat s'est rendue[80].
Nous avons le temps, avant le dîner, d'aller rue de Tournon voir amener le drapeau à croix gammée. Nous suivons la foule bruyante qui s'y rend avec enthousiasme.
La rue est noire de monde, noire de spectateurs des aux fenêtres pavoisées. Les immeubles saignent encore de toutes leurs blessures, les vitres sont crevées partout. La foule hurle.
À grand peine un chemin est frayé au milieu de la chaussée envahie, pour laisser passer les acteurs du dernier acte du drame.
Les acclamations déferlent pour chaque passage de voiture F.F.I. ou de camion Leclerc. Les F.F.I. de la police sont particulièrement applaudis[,] leur brillante conduite à la Préfecture et à l'Hôtel de Ville est connue de tous.
Soudain, une grande rumeur s'élève. Un garde républicain amène le drapeau à croix gammée, il le montre d'un geste large à la population. Il le roule en boule au milieu de frénétiques clameurs.
Puis, quelques minutes après, c'est le drapeau tricolore qu'on hisse et les clameurs redoublent. L'instant est pathétique et c'est un souvenir que n'oublieront jamais ceux qui ont eu le privilège d'assister à un tel spectacle.
Nous attendons la sortie escomptée des prisonniers. Notre voisine dans la foule se trouve être une habitante des logements réservés, au-dessus de Saint-Sulpice, aux serviteurs de l'église. Elle nous dit que, contrairement à tout ce que le quartier croyait, il n'y a pas eu de tireurs sur l'église.
Justement, les tireurs des toits recommencent à tirer sur la foule vers le haut de la rue, côté rue de Condé. Personne ne bouge et personne semble-t-il n'a été atteint.
Le drapeau à croix gammée est ramené à la caserne de la garde républicaine par un groupe de gardes[81].
Au bout d'une demi heure nous rentrons dîner et nous reviendrons après dîner.
Le jour est près de baisser lorsque nous repartons, mais, dès les premières maisons de la rue de Tournon on nous dit que les prisonniers S.S. sont toujours là, et nous partons vers le boulevard Saint-Germain au bout d'un quart d'heure[82].
Avant de quitter la rue de Tournon nous voyons un milicien arrêté et encadré par un groupe de F.F.I. La foule crie "à mort". Ce petit tableau dans l'ombre grise du crépuscule est sinistre. Ce milicien, encore en costume d'uniforme, est chauve et quinquagénaire ce n'est pas la silhouette qu'on attendait. Il est parfaitement calme, c'est sans doute un vieux cheval de retour qui savait le jeu qu'il jouait.
Quand nous arrivons boulevard Saint-Germain, il fait nuit. Du boulevard Saint-Michel débouche tout-à-coup la fanfare des pompiers de Paris, avec tambours et clairons, qui fait une gaie et retentissante retraite sans flambeaux.
Ginou est ravie et, du trottoir, nous emboîtons le pas, direction de Saint-Germain-des-Prés. Des nuées de jeunes gens et jeunes filles du quartier latin suivent en chantant[83].
Tout-à-coup au coin de la rue de Seine une auto de F.F.I. passe en trombe en nous frôlant, les occupants nous braquent littéralement leurs revolvers sous le nez.
Comment ont-ils été prévenus ? Aussitôt, en effet, une salve nourrie de coups de feu est tirée des toits sur la retraite et ses suivants. La nuit nous empêche de distinguer s'il y a des blessés parmi cette nombreuse jeunesse, mais je serais surpris du contraire.
Mais la retraite continue vers la rue de Rennes, les suiveurs se regroupent et nous rentrons, toujours salués par les tireurs des toits qui tirent maintenant par coups isolés.
SAMEDI 26 AOUT
Allons visiter le champ de bataille avant que rien ne soit encore dérangé par la multitude des curieux. À 8 h 1/2 avant que les enfants soient debout, je pars avec Yette dans cette intention[84].
Rue Servandonie (sic) et rue Férou, les riverains s'emparent des odieuses barrières, quelques-uns les débitent sur place et en feront du combustible pour remplacer le gaz absent.
Rue Bonaparte, carreaux cassés et traces de balles sur beaucoup de maisons.
Au carrefour Vaugirard-Guynemer on se masse autour d'un blockaus (sic) dissimulé derrière l'angle de la grille du jardin avec un art tellement consommé qu'il avait échappé au regard des riverains eux-mêmes. C'est un habitant d'ailleurs qui, paraît-il, l'a aperçu le premier et l'a révélé aux F.F.I. intéressés. Il ne porte que quelques traces de balles, et c'est de là sans doute qu'est partie la rafale de mitrailleuse qui tua une jeune fille, place Saint-Sulpice, samedi dernier[85].
Rue Guynemer, les immeubles ont peu souffert, mais le blockaus (sic) face à la rue de Fleurus a été touché en plein et écrasé et derrière, dans le jardin, la guérite bétonnée des sentinelles est éventrée de part en part d'un énorme trou. Dans la grande allée de marroniers (sic), quelques arbres sont fracassés, une petite auto gît désemparée et des caisses vides, des munitions sans doute, traînent çà et là.
Mme Voisin et Clotilde sont à leurs fenêtres[86]. Nous leurs (sic) parlons un instant. Elles étaient aux premières loges et ont dû avoir chaud.
L'immeuble 78 rue d'Assas, ainsi que la pension de famille "Les Marroniers" (sic) au coin gauche de la rue Vavin ont reçu de rudes coups[87]. Le blockaus (sic) face à la rue Vavin est écrasé de coups de canon et le pavillon du concierge, derrière, a reçu une pluie de balles.
C'est la rue Auguste-Comte qui montre le plus de ravages. Le lycée Montaigne porte des plaies béantes, les sacs de sable des défenseurs sont encore aux fenêtres dont quelques-unes sont éventrées sur les côtés. Quatre blockaus (sic) à l'entrée du lycée sont également touchés.
Une petite voiture automobile de marque française est aplatie sur la chaussée, plus loin c'est un camion genre autobus qui a été détruit, des Parisiens s'affairent déjà à enlever les dépouilles ; plus loin encore c'est un camion chargé de balles de papier qui flambe encore.
Nous marchons littéralement sur un tapis de verre pilé, de feuilles de platanes déchiquetées, de débris de toute nature. Les cyclistes doivent mettre pied à terre.
La grille du Luxembourg est par endroits tordue et déchiquetée comme s'il s'agissait de fétus de paille. Je ramasse un fleuron coupé net qui servira de presse-papier historique à Ginou[88].
L’École Coloniale[89] n'a que quelques carreaux cassés, mais la grille d'entrée face du Luxembourg face à l'avenue de l'Observatoire porte de sérieuses blessures, un montant de pierre est effondré, un autre décapité. Sont décapités aussi plusieurs arbres du jardin les plus proches.
Les verrières du jardin de l’École des Mines sont naturellement en piteux état de même que le blockaus (sic) et la guérite bétonnée face à la rue de l'Abbé-de-l'Epée, tous deux touchés en plein.
Boulevard Saint-Michel, l’École des Mines par où sont passés hier les F.F.I. pour prendre à revers la garnison du Sénat a été copieusement mitraillée.
Çà et là, des immeubles de l'autre côté du boulevard ont reçu des éclaboussures : au 87 une plaque à la mémoire de Branly a été brisée, au 85 une fenêtre de l'association des étudiants en pharmacie est éventrée.
Encore un blockaus (sic) démoli au canon en face de la rue Royer-Collard. Puis, au carrefour Soufflot, derrière la grille d'entrée du Luxembourg, un petit tank allemand stationne entouré de 3 ou 4 tanks de la division Leclerc garnis de leurs occupants.
Le carrefour Médicis nous montre son bassin touché, grilles de fer et pourtour de pierre. Le café Capoulade, au coin de la rue Soufflot[90], a reçu une grêle de balles ainsi que le kiosque à journaux à côté. En face le "Soldatheim" (sic) entre la rue Monsieur-le-Prince [et ?] n'est que ruines et le kiosque à journaux est littéralement pulvérisé.
Nous tournons rue de Médicis. Encore un blockaus (sic) écrasé, des arbres décapités des barreaux de grille coupés net.
Le théâtre de l'Odéon a des écorchures. Une maison limitrophe du restaurant "Le Cochon de Lait" a brûlé de fond en comble, les pompiers y sont encore.
À l'entrée du jardin, un dernier blockaus (sic) écrasé. On aperçoit l'immense taupinière édifiée par les Allemands depuis des mois et dont le béton a défié les balles des attaquants.
Le chalet de W.C. très abîmé a des plaies béantes. Naturellement, cela prête à des plaisanteries qui réjouissent le bon peuple des curieux.
Un tank "Tigre" est immobilisé sur la chaussée. Un farceur a découpé le mot "relâche" sur une affiche du Théâtre et l'a collé dessus. Gros succès pour cette manifestation de la verve populaire.
L'aile gauche du Sénat, principalement la belle cheminée, est très endommagée.
L'endroit est très spectaculaire. Les photographes amateurs tirent force clichés. Les F.F.I. se font complaisamment tirer soit à côté du tank "Tigre", soit à bord de leurs petits véhicules, armés jusqu'aux dents et la pose triomphale.
Un regard sur la façade du Sénat relativement peu meurtri et nous rentrons par la rue Garancière si longtemps interdite.
Au retour, Ginou manifeste le désir de faire elle aussi ce pèlerinage et je refais avec elle le même chemin.
Nous y ajoutons une promenade sur la partie inférieure du boulevard Saint-Michel, où les immeubles n'ont pas trop souffert malgré les combats particulièrement meurtriers qui s'y sont déroulés.
Le boulevard résonne d'une vie intense. La foule joyeuse assiège les camions et tanks de la division Leclerc, massés sur les trottoirs sous les arbres. Les soldats sont fêtés et ovationnés sans arrêt.
Comme nous rentrons déjeuner, nous apprenons que le général de Gaulle, à 3 h, partira de l'Arc de Triomphe et se rendra à Notre-Dame par la rue de Rivoli.
À 2 h, je pars avec Ginou. Guy va, de son côté, avec des camarades. Yette fatiguée, se récuse seule.
Il fait un magnifique soleil et le boulevard Saint-Germain, pavoisé à foison, grouille d'une foule intense, pavoisée elle aussi au revers des vestons, au corsage et aux cheveux des jeunes filles.
Barrage rue de Solférino. Nous obliquons et après les péripéties ordinaires en pareille occurrence, nous arrivons à nous caser très bien, face au Ministère de la Marine, non loin de l'esplanade de l'Orangerie des Tuileries.
Une longue attente sous le soleil écrasant, parmi la foule immense. On acclame les F.F.I., la division Leclerc. À côté de nous, sur une vaste auto, un reporter français et un reporter américain parlent tour à tour au micro. Ils font chanter la "Marseillaise" à ceux qui les entourent.
Enfin, le cortège arrive. Ginou seule peut bénéficier d'une chaise pour bien voir et elle m'explique le cortège.
De Gaulle, qui lui fait une excellente impression, est follement acclamé. Les ovations continuent, accompagnant la suite du défilé.
Il y a près de 10 minutes que la foule stationne toujours en applaudissant lorsque, brusquement, un crépitement de coups de feu part, semble-t-il, des toits du ministère de la marine et de l'Hôtel Crillon. À mon avis, il doit y avoir des tireurs aussi dans les arbres de l'esplanade de l'Orangerie, mais je n'en distingue aucun nulle part.
Le premier moment de stupeur passé la foule cherche à fuir. Les F.F.I. du service d'ordre conseillent à la population de se coucher par terre sur place, conseil suivi assez bien.
Sur les toits du ministère de la marine et de l'Hôtel Crillon apparaissent de nombreux défenseurs – américains disent les uns, F.F.I. disent les autres – qui tirent rudement.
La foule fait un bond pour se recoucher à 50 mètres plus loin. Le calme tend à revenir lorsque les tanks de la division Leclerc, qui sont peut-être une trentaine ouvrent un feu nourri de mitrailleuses et même de canon. Je vois les carreaux voler en éclat aux grandes fenêtres du ministère de la marine[91].
Il en résulte un vacarme infernal qui effraye surtout les spectatrices féminines. Il n'y a pas de panique générale, mais si l'on peut dire, des îlots de panique.
Nous allons nous abriter contre un autobus de la Croix-Rouge. Deux femmes pleurent à chaudes larmes. Je leur dis qu'il n'y a pas de danger, l'une répond "J'ai peur" et l'autre qui a bien 35 ans, crie "Maman". D'autres jeunes femmes se jettent à plat ventre, sans regarder, dans un tas de fils de fer barbelés, vestiges de la récente bataille des Tuileries[92].
Ginou est très crâne[93] et dit même qu'elle n'est pas fâchée d'avoir vu ça.
De nouvelles vagues de femmes affluent autour de notre autobus. J'en rassure quelques-unes en leur disant que toute cette mitraille passe bien au-dessus de nous et qu'il n'y a aucun blessé autour de nous, mais seulement des personnes évanouies ce qui est d'ailleurs vrai en ce secteur.
Nous prenons le parti de quitter les lieux sans attendre la fin de la bagarre et nous y réussissons assez aisément.
Mais on tire du Cours-la-Reine, du Palais-Bourbon, du quai Voltaire. Les gardes républicains ripostent en pure perte par-dessus le fleuve.
Nous passons par la rue de Lille. En débouchant rue des Saints-Pères, nous percevons des vociférations et voyons un groupe agité se dirigeant vers la Seine. C'est, nous dit-on, un tireur des toits qui vient d'être pris sur le fait et qu'on va exécuter sur place. Ce n'est pas un spectacle pour Ginou et nous nous écartons, sans avoir vu ce qui s'est passé au juste, mais non sans avoir entendu une salve de coups de revolver.
Et jusqu'à la maison, on tire sur les toits. Au coin de la rue Garancière, on ramasse devant la maison d'éditions "Alsatia"[94] un jeune homme blessé au côté. Il a, paraît-il, décelé un tireur des toits et comme il le désignait du doigt, le malfaiteur l'a abattu.
Yette, au courant de la fusillade, se rassure en nous voyant. Guy, qui lui, était aux Tuileries, arrive aussi indemne. Il a, en rentrant, aperçu distinctement un tireur sur le toit de l'hôtel de la Monnaie[95].
Et ces émotions ne sont pas les dernières de la journée. Dans la nuit c'est un bombardement furieux de la "Lutwaffe" (sic) – le coup de pied de l'âne – qui réveille toute la maison. Devant l'ampleur de l'éclairage, nous nous levons et descendons.
Une lueur d'incendie, telle que nous n'en avons jamais vue au cours des multiples alertes de cette guerre, remplit le ciel d'une immense illumination rouge. On distingue aussi deux autres foyers d'importance moindre.
L'avis général est que ce sinistre exceptionnel doit se situer aux alentours de la Gare d'Austerlitz.
Nous pressentons que les dégâts doivent être graves et les victimes nombreuses[96].
DIMANCHE 27 AOUT
Journée plus calme. Faisons le point. La division Leclerc parle déjà de départ et va faire place aux anglo-américains de plus en plus nombreux, de plus en plus fêtés, idoles des jeunes filles.
La chasse aux collaborateurs est commencée, des listes circulent. Les arrestations se succèdent et le vélodrome d'hiver se remplit. Parmi les internés les plus connus figurent Paul Chack[97] et Sacha Guitry[98].
Les Allemands se regroupent fiévreusement devant Belfort. Dans le Sud, Antibes, Arles, Tarascon, Avignon, Cavaillon, Carcassonne sont libérés.
Le bombardement d'hier soir a été terrible. La Halle aux Vins est détruite.
C'est le but de notre promenade de l'après-midi. Les ruines sont fumantes et les pompiers sont toujours là. Les maisons voisines sont intactes, mais il paraît que, derrière, la rue Monge a beaucoup souffert.
En revenant par les quais, nous saluons au passage la Préfecture aux glorieuses blessures. Nous voyons le Notre-Dame Hôtel au coin de la rue des Deux-Ponts, incendié avec ses drapeaux de pavoisement calcinés. Au pied, deux camions anéantis, dont l'un sans doute est à l'origine de l'incendie.
Dehors, partout, la grande foule des dimanches d'autrefois, avec, en plus, tous nos amis des armées alliées.
LUNDI 28 AOUT
Retour à pied au bureau par mon chemin habituel.
On peut maintenant passer carrefour Saint-Germain-des-Prés, où que je me faisais canarder il y a quelques jours par les S.S.
Rue Saint-Benoît, ce ne sont plus des camions allemands, mais des "Jeeps" américaines qui stationnent devant l'hôtel Cristal et l'hôtel Montana, objet de deux attentats à la bombe pendant l'occupation.
Rien de changé rue des Saints-Pères où fourmillent nos chers drapeaux.
Au pont des Saints-Pères, deux batteries américaines de D.C.A. entourées de passants.
Aux guichets du Louvre, des agents règlent la circulation, spectacle oublié.
D'autres batteries de D.C.A. yankees entourent l'Arc du Carrousel.
Le pavillon de Marsan[99], encore ceint de barbelés, garde des traces de balles, les lions de pierre sont défigurées (sic).
Jeanne d'Arc toute dorée n'a rien, mais l'hôtel Regina a été mitraillé[100]. Vingt-cinq drapeaux flottent aux fenêtres où, naguère, apparaissaient les gretchen de l'armée allemande, les souris grises[101]. Où sont-elles ?
Je pense au petit marin paraissant 16 ans qui, les derniers jours, montait la garde devant la porte. Il semblait écrasé par sa responsabilité et arrondissait des jeunes yeux bleus de faïence. Où est-il lui aussi ?
Rue des Pyramides, au 10, le siège du P.P.F. de Doriot a été saccagé[102]. Des monceaux de fascicules de propagande jonchent le sol. Le blockaus (sic) est intact, ses défenseurs avaient pris du large à temps.
Jusqu'au bureau, rien de particulier. Les Américains prennent possession des hôtels évacués par les Allemands, à la joie du public.
Je note seulement qu'au coin de la rue de Choiseul, le petit café qui s'enorgueillit d'avoir été maltraité en 1870 et en 1914 est, cette fois, indemne – que rue de Hanovre le silence succède aux bruyants ébats des Allemands qui venaient y chercher bon accueil – que rue des Italiens les Américains ont déjà remplacé les pionniers du chemin de fer de la Werhmacht – qu'au coin de la rue Taitbout l'ex-restaurant du Grand V, jadis célèbre et transformé en taverne tyrolienne avec des peintures murales amusantes, est vide et désolé[103].
Une barricade rue de Châteaudun et une rue Saint-Lazare devant mon bureau même.
Tous mes collègues sont sains et saufs. Ceux de banlieue sont encore absents et quelques-uns ne sont pas encore libérés.
Reprenons notre travail, la semaine héroïque est terminée.

André Auvinet en 1939, à son bureau dans une salle du casino de Trouville réquisitionné par la SNCF.
[1] Il était né en 1888.
[2] Le titre est au stylo à bille noir, suivi de la mention : « écrit par Bon-Papa », de la main de Geneviève.
[3] On a respecté dans la transcription la graphie, la ponctuation, les ratures et l'orthographe d'André.
[4] Ferdinand Dupuy : « La Libération de Paris vue d'un Commissariat de Police », Paris ; Librairies Imprimeries Réunies, 7, rue Saint-Benoît, 1945, 56 p. Ce même auteur a aussi écrit, en 1947, le récit symétrique de l'arrivée des Allemands dans la capitale : Quand les Allemands entrèrent à Paris. L'arrière-plan historique de tout ceci a été contrôlé par la lecture du livre d'Adrien Dansette, qui fait autorité : « Histoire de la libération de Paris », Paris : Perrin 1994 (réédition de l'édition de 1977, remaniée et augmentée, d'un ouvrage écrit en 1946). On n'a pas systématiquement cité cet ouvrage, mais les commentaires au texte d'André lui doivent beaucoup, ainsi que diverses recherches sur Internet, notamment sur le site consacré à la libération de Paris de Gilles Primout (https://liberation-de-paris.gilles-primout.fr/).
[5] Geneviève a ajouté, entre parenthèses, la précision de l'année : 1944.
[6] Il sera question plusieurs fois de ce trajet domicile-travail, qu'André empruntait régulièrement, même en temps ordinaire, car il adorait marcher dans Paris. Il travaillait rue Saint-Lazare. De Saint-Sulpice où il demeurait, il passait par la rue de Seine, le pont des Arts, les Guichets du Louvre, l'avenue de l'Opéra ou la rue des Pyramides, et les Grands Boulevards. Cette géographie, avec celle du Quartier Latin, est très présente dans les pages qui suivent.
[7] Les conducteurs du métro s'étaient mis en grève à ce moment.
[8] En réaction à l'arrestation le 13 août au matin des gardiens de la paix des postes de police de Saint-Denis et d'Asnières, la Préfecture de Police a ordonné aux gardiens de quitter armes et uniforme pour échapper plus facilement à une éventuelle arrestation. « On assiste à ce spectacle peu banal d'un Paris sans gardiens de la paix !… » (Dupuy 1945 : 4). Suite à des assurances allemandes, les agents reprennent le travail le même jour à 13 h 30, mais se mettent en grève le 15 août au matin à l'appel de la Résistance, suivis par l'ensemble des personnels de la Préfecture et des commissariats. La grève cesse le 19 août, mais les agents rejoignent leur poste dans les commissariats en tenue civile, après le remplacement de la plupart des gradés par des policiers de la Résistance (Dupuy 1945 : 5-11). Ils reçoivent l'ordre de reprendre leurs uniformes le 23 août à 16 heures. Leur présence, bien oubliée maintenant qu'ils sont remplacés par des feux tricolores, était nécessaire à la circulation et formait un élément essentiel de l'atmosphère parisienne : ainsi André peut-il s'écrier, le 25 août : « Les agents de police reprennent leur service en uniforme, la vue de leur silhouette familière manquait. »
[9] Voir la notation correspondante de Dupuy 1945 : 3, pour le 12 août : « Curieux et narquois, les Parisiens considèrent ces préparatifs de départ, faisant effort pour ne pas laisser échapper à l'adresse des ‘fridolins’ les lazzi que leur suggère ce réconfortant spectacle. »
[10] Les célèbres Grands Magasins Dufayel, fondés en 1856, vendaient des articles d'équipement de la maison et d'ameublement. Il s'agissait du plus grand magasin de ce type au monde, qui employait 15 000 personnes en 1912. Toutefois, André cite ce nom par habitude, car ils cessèrent leur activité en 1930. Après la Seconde guerre mondiale, la BNP y installa ses services centraux.
[11] Grande manifestation des ligues d'extrême-droite, qui dégénéra en émeute insurrectionnelle place de la Concorde, durement réprimée par la police (16 morts et 120 blessés chez les émeutiers, et un garde républicain tué). Cela entraîna la démission du gouvernement Daladier.
[12] La grève avait été décrétée le 10 août, à l'appel de la Résistance. Elle mêlait des revendications salariales, la demande de 500 grammes de pain par jour, la libération de manifestants arrêtés le 14 juillet précédent et « la volonté d'en finir avec les Boches », en paralysant les transports de troupe et de matériel allemands. (http://comprendreexpliquercombattre.wordpress.com/2011/07/15/greve-generale-chez-les-cheminots-1944/ – site de l'Union des Étudiants Communistes ; Dansette 1994 : 135-136).
[13] Apparue dans les revendications syndicales dès 1906, la « semaine anglaise » (c'est-à-dire de cinq jours) ne s'imposa que dans les années 1950-60. Elle commençait cependant à se répandre, surtout dans les usines, depuis le Front Populaire.
[14] Restaurant célèbre aujourd'hui disparu, fondé vers 1860 sur les Grands Boulevards (34-36 boulevard Bonne Nouvelle), à côté du théâtre du Gymnase.
[15] Le Grand Rex, qui existe encore au 1, bd. Poissonnière, toujours sur les Grands Boulevards.
[16] Ce cinéma était 27, bd. Poissonnière. Il a fermé en 1987. Soldatenheim et Soldatenkino étaient des foyers de divertissement réservés aux Allemands. Il y avait cinq Soldatenheim et trois Soldatenkino à Paris (il y avait aussi des cafés et des théâtres réservés) (http://www.occupation-de-paris.com/2012/04/soldatenheim-kino-kaffee-theater.html).
[17] Dupuy 1945 : 10, signale ainsi à la date du 16 août que « tous les hôtels où logeait ces Messieurs [les Allemands] sont à peu près vides ».
[18] Elles se sont mises en grève ce 19 août. Il s'agissait alors de services administratifs. L'insolite de cet épisode, qui a obligé les Parisiens à transporter eux-mêmes leurs morts (voir Dansette 1994 : 247-248), a donné lieu à diverses évocations littéraires, comme dans le « Journal de la France 1939-1944 » d'Alfred Fabre-Luce, ou « La Bicyclette bleue » de Régine Deforges (qui habitait d'ailleurs à Saint-Sulpice), et d'autres encore.
[19] Le Palais de Justice de Paris, dans l'île de la Cité. André, avocat, était employé aux services juridiques des Chemins de Fer, et devait donc plaider pour son employeur.
[20] Forces Françaises de l’Intérieur. Elles sont le résultat de la fusion, au 1er février 1944, des principaux groupements militaires de la Résistance intérieure française qui s'étaient constitués dans la France occupée, des gaullistes aux communistes.
[21] Yette est le diminutif d'Henriette, la femme d'André (Jeanne-Henriette Noutary, 1898-1997).
[22] André avait deux enfants : Guy, né en 1924, avait donc 20 ans, et Geneviève, née en 1928, avait 16 ans.
[23] Ginou est le diminutif de Geneviève.
[24] Dupuy 1945, ne signale pas de F.F.I. à cette date au commissariat du 6ème arrondissement, qui « occupait à la mairie un grand local situé au rez-de-chaussée » (Dupuy 1945 : 23). Mais le 20 août, il indique (p. 18) que « les agents, toujours en manche de chemise (il fait très chaud), munis de brassards F.F.I., le pistolet à la ceinture ou la mitraillette en bandoulière, sillonnent les rues, recherchant les fridolins. » La mobilisation officielle des F.F.I. s'est faite en effet le 20 à la demande du colonel Rol, selon le récit d'André. Il se peut que celui-ci ait vu le 19 le départ du commissariat de policiers convoqués en renfort à la Préfecture de Police qui avait été prise le matin par les résistants de la police, et que les Allemands essayaient de reprendre : « ils étaient donc 50 qui, partant de la place Saint-Sulpice, se dirigèrent vers la place Saint-Michel (…) bien décidés à ‘descendre’ chacun leur boche » (Dupuy 1945 : 13). Cet épisode est raconté par Dansette 1994 : 155 : « au début de l'après-midi, un groupe d'hommes en corps de chemise, armés de revolvers, occupent les abords de la place [Saint-Michel] (…). Ce sont des F.F.I. et des gardiens de la paix qui tendent une souricière aux voitures allemandes.»
[25] Cette information était globalement exacte. L'état-major de la Luftwaffe pour tout le Front de l'Ouest s’était installé dans le Palais en 1940 et y avait réalisé des aménagements défensifs. Le personnel de l'état-major a quitté les lieux à partir du 10 août et a été remplacé par une troupe d'environ 600 hommes sous les ordres du colonel von Berg et composée en partie de S.S. (https://liberation-de-paris.gilles-primout.fr/esenat.htm).
[26] Rappelons que la rue Palatine, où habitait André, longe l'église Saint-Sulpice, qui en constitue le côté nord.
[27] Cette réserve prudente semble justifiée. Dupuy 1945 : 18, note que « la nuit du 19 au 20 août s'est passée dans le calme (…) Les coups de feu sont très rares dans Paris ».
[28] Henri Tanguy, dit colonel Rol (1908-2002) ou Rol-Tanguy depuis 1970, était un militant communiste actif dans la Résistance depuis octobre 1940. Colonel dirigeant la région parisienne, il est le principal artisan de la libération de Paris par les F.F.I.
[29] En effet, c'est le dernier pseudonyme de Tanguy, nom d'un combattant des Brigades Internationales, Théo Rol, tué en 1938 pendant la bataille de l'Èbre, en Espagne.
[30] Dansette 1994 : 190, note pour ce dimanche que « les rues seraient vides (…) sans le va-et-vient des fidèles sortis pour se rendre à la messe ».
[31] Cette inconscience est également signalée par Dansette 1994 : 191, « toute la semaine, il se trouvera des Parisiens insouciants ou indifférents qui ne changeront rien à leur existence ».
[32] Le point d’interrogation est d’André. Il y avait effectivement des asiatiques, sans doute Japonais, parmi ces tireurs embusqués, comme en témoigne une photographie publiée sur le site de Gilles Primout (https://liberation-de-paris.gilles-primout.fr/etireurs.htm). Il est possible qu'il s'agisse de l'épisode raconté pour ce même jour par Dansette 1994 : 192, « rue de Buci [la rue de Buci est dans le prolongement de celle de Montfaucon], des F.F.I. extirpent d'un hôtel quelques Japonais que les spectateurs déculottent et fessent. »
[33] André veut sans doute dire « parisien », par opposition à national. De fait, cette trêve était négociée entre le général von Choltiz, commandant de Paris et la région (« Gross-Paris »), et l'état-major parisien des F.F.I. Elle s'achèvera le 21, du fait de la Résistance (sur cette trêve, prémisse de la capitulation allemande, voir Dansette 1994 : 177-221, et Dupuy 1945 : 18).
[34] Dupuy 1945 : 20, évoque ces visites des habitants du quartier : « au commissariat où, cent fois par jour, on nous pose cette question, nous croyant mieux informés, je réponds : Patience, ‘ils’ sont très près et leur arrivée est certaine. » Ou bien, p. 33 : « Il me suffit de sortir du bureau et de faire quelques pas dans la rue pour que des personnes du voisinage se précipitent à ma rencontre et m'interpellent : ‘alors, quoi de neuf ? Où sont-ils ?’ » (le 23 août).
[35] Le message était le suivant : « En raison de la promesse faite par le commandement allemand de ne pas attaquer les édifices publics occupés par les troupes françaises et de traiter tous les Français prisonniers conformément aux lois de la guerre, le Gouvernement provisoire de la République française et le Conseil national de la Résistance vous demandent de suspendre le feu contre l'occupant jusqu'à l'évacuation totale de Paris. Le plus grand calme est recommandé à la population. On est prié de ne pas stationner dans les rues » (Dansette 1994 : 437). Cette absence d'échéance, pointée avec finesse par André comme le point essentiel de la proclamation, était très importante aux yeux de ceux qui souhaitaient éviter une insurrection, tant du côté français qu'allemand : on espérait ainsi obtenir la tranquillité de la Résistance sur une promesse sans calendrier.
[36] En effet, la trêve a été annoncée par des véhicules de F.F.I. et allemands allant conjointement, munis de haut-parleurs, à partir de 15 h 30 : la chronologie d'André concorde bien (Dansette 1994 : 193).
[37] Les Couteau habitaient le même immeuble, au quatrième étage.
[38] Voir Dupuy 1945 : 18, « cette suspension de combat n'est que relative. Des Allemands (…) continuent de tirer, s'attirant ainsi la riposte des nôtres ». Les S.S., surtout, ont été très réticents à appliquer l'ordre de von Choltiz, mais de nombreux F.F.I. ne l'appliquèrent pas non plus, à cause des querelles entre les groupes de la Résistance ; le quartier Latin a été un des plus touchés par les tirs (Dansette 1994 : 195).
[39] En effet, la trêve est rompue (quand elle a été respectée) par les fractions communistes et nationalistes de la Résistance, qui seront rejointes par une grande majorité de F.F.I.
[40] Dupuy 1945 : 10, signale déjà qu'au 17 août « le gaz est entièrement coupé, l'électricité extrêmement réduite ». André indique au 22 août 20 minutes d'électricité.
[41] Les mairies, fermées, ne délivrent plus de tickets d'alimentation (Dupuy 1945 : 19).
[42] Dupuy 1945 : 19, indique, au 20 août, que « ceux qui ne disposent pas de charbon ne peuvent plus faire cuire leurs aliments. »
[43] Voir l'évocation par Dupuy 1945 : 24, à la date du 22 août : « Furtivement, en rasant les murs, les ménagères profitent d'une accalmie pour faire des achats puis disparaissent en hâte ».
[44] La rue de Tournon, qui donne devant la porte du Sénat occupé par les Allemands, était particulièrement visée par ces derniers.
[45] Dupuy 1945 : 35, raconte cette réapparition à la date du 23 août : « Se substituant aux journaux ‘collaborateurs’, disparus depuis le 18 août, une nouvelle presse apparaît soudain au grand jour après avoir lutté courageusement dans la clandestinité. Voici Combat, Libération, Défense de la France et bien d'autres feuilles. (…) Naguère feuilles minuscules, ne dépassant pas les dimensions d'un tract, elles se sont agrandies au format du journal ordinaire et, sous des manchettes énormes, annoncent les victoires alliées et la très proche libération de Paris. Le public lit avidement les nouveaux quotidiens qui parlent un langage altier, libre, français… »
[46] À cette formule fait écho celle de Dupuy 1945 : 20 : « Hélas, les désirs sont une chose et les nécessités militaires en sont une autre dont la complexité échappe aux profanes. »
[47] « La rue de Seine, dans le prolongement de la rue de Tournon, est une des plus visées par les Allemands qui, des portes du Sénat, ne cessent d'y diriger des rafales de mitrailleuses et de petits obus perforants. » (Dupuy 1945 : 24, à la date du 22 août).
[48] Les réticences venaient essentiellement de la crainte d'une prise de pouvoir par les communistes. Cela pouvait se concevoir, car la résistance intérieure, notamment parisienne, était très largement le fait de communistes ou sympathisants. Les 18 et 19 août, de nombreuses mairies de banlieue et quelques mairies d'arrondissement de Paris tombent d'ailleurs aux mains des communistes (Dansette 1994 : 157-160).
[49] Dès le 17 août, le colonel Rol avait diffusé dans une instruction la recette du cocktail Molotov, largement employé (Dansette 1994 : 234). Dupuy 1945 : 14, évoque un tel acte, mais sans la bouteille d'essence, à la date du 19 août : « Un jeune homme, une grenade à la main, s'approche [d’un camion], lance son engin sur le moteur et, vite, se glisse sous le véhicule pour éviter les éclats de l'explosion. »
[50] Au soir du 22 août, Dupuy 1945 : 30, établit le bilan suivant : « Au cours de ces jours de combat, les gradés et gardiens du 6ème arrondissement ont (…) tué 50 Allemands, en ont blessé 40 et capturé une trentaine. » Six brigadiers et sept gardiens ont été blessés et admis à l'hôpital, un brigadier-chef, un brigadier et deux gardiens ont été tués.
[51] Aimé-Joseph Darnand (1897-1945), militant actif d'extrême-droite, fondateur et dirigeant de la Milice Française en 1943, organisation paramilitaire de type fasciste, supplétive de la Gestapo et chargée de la traque des résistants, des Juifs et des réfractaires au STO. Il fut condamné à mort à la Libération et fusillé.
[52] Dupuy 1945 : 41 ne fait allusion que deux fois à des tireurs embusqués sur les toits. D'une part en racontant la mort, vers 17 h le 25 août, dans un appartement de la rue Bonaparte, de la femme d'un de ses amis, touchée en plein cœur, ainsi qu'un autre locataire : « le ou les auteurs de cet attentat (Allemands ou miliciens) n'ont pu être découverts. On soupçonne qu'ils se cachent sur le toit d'un immeuble situé en face, mais les recherches sommaires faites sur le champ demeurent sans résultat. » Et d'autre part lors du passage du cortège du général de Gaulle le 26 août. Mais on se rappelle que Dupuy n'a guère quitté son commissariat. Dansette 1994 : 349-351, indique que c'est ce mercredi que les tireurs des toits commencent d'être signalés, et leur nombre sera maximum le vendredi, jour de la reddition allemande. Il s'agissait pour l'essentiel de miliciens, qui déclenchèrent une psychose dans Paris, même si leur nombre réel dut être limité.
[53] Le général Pierre Koenig (1898-1970) était commandant suprême interallié, commandant supérieur des forces françaises en Grande-Bretagne et surtout commandant des forces françaises de l'intérieur (F.F.I). Il est, sur de nombreux points, en désaccord avec le comité militaire d'action de la Résistance. Sa nomination au poste de gouverneur militaire de Paris est considérée par certains comme destinée à limiter, et le cas échéant à combattre, l'action du Parti communiste.
[54] Le général Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952) avait rejoint le général de Gaulle à Londres en 1943, qui le nomma commandant de la Première Armée Française. Il débarque en Provence le 16 août 1944 et prend Toulon et Marseille. Puis il remonte la vallée du Rhône en prenant Lyon et les Vosges, puis le Rhin, libère l’Alsace et entre en Allemagne jusqu'au Danube. Il représente la France à la signature de la capitulation allemande du 8 mai 1945 à Berlin. Entre secret militaire et absence de journaux, il a donc fallu une semaine pour que les Parisiens soient informés de ce débarquement.
[55] Raymond Caudrilliers, dit Aimos, né en 1891, était un des plus populaires seconds rôles du cinéma français. Il s'était engagé dans la Résistance et avait le grade de caporal des F.F.I. Pendant l'occupation il ouvrit, rue Montmartre, un restaurant pour les enfants nécessiteux : l'Oeuvre des Gosses d'Aimos. Plusieurs versions de sa mort circulent, sans que le mystère ait été éclairci : il aurait pris part à un coup de main au pont de Joinville avec des résistants, ou bien aurait été abattu sur une barricade rue Louis Blanc, ou tué par une patrouille allemande, à moins qu'il n'ait été victime d'un règlement de comptes et assassiné d'une balle dans le dos.
[56] Le 23 août à 7 h du matin, un gardien de la paix tire d'une fenêtre du commissariat de l'avenue de Sèlves sur une colonne allemande descendant les Champs-Élysées. Les Allemands attaquent le Grand Palais avec des chars lourds et font sauter un angle de la façade sur l'avenue de Sèlves. C'est le début d'un incendie, alimenté par la paille utilisée pour la ménagerie d'un cirque suédois installé dans la nef ; un cheval tué est aussitôt dépecé par la population. Pendant quarante-huit heures, le feu dégage une fumée noire et provoque des dommages importants. Le 26 août, les Gi's installent leurs jeeps dans la nef, suivis de peu par celles de la 2ème DB (source : RMN ; voir aussi Dansette 1994 : 243).
[57] On sait qu'en fait les tractations ont été difficiles entre le commandement allié et le général de Gaulle. Le général Eisenhower avait certes promis au général Leclerc qu'il entrerait le premier dans Paris, mais il temporisait car il voulait contourner Paris pour arriver plus vite à Berlin. De Gaulle l'a menacé de passer outre son autorité, et arguant d'une situation favorable aux alliés (faiblesse des Allemands ne souhaitant pas la destruction de Paris), a persuadé Eisenhower de laisser Leclerc marcher sur Paris, accompagné d'une division américaine. Cette décision a été prise le 22 au matin, et a donc été très vite connue dans la capitale. Il est difficile de savoir si André maniait ici l'euphémisme, ce qui était bien son genre, ou s'il était simplement victime de la propagande gaulliste.
[58] La B.B.C. avait annoncé ce jour à 12 h 30 la libération de Paris, ce qui était prématuré, et la mission de Leclerc était bien d'arriver le 24, ce qu'il fit (Dansette 1994 : 285).
[59] La Roumanie a capitulé le 23 août devant les armées de Staline. C'est le journal Libération qui a annoncé le premier la nouvelle, journal dont, semble-t-il, André était devenu un lecteur quotidien. Son commentaire est fort pertinent : la presse, dans les jours suivant, analysant les effets de cette capitulation, considère qu'elle sonne le glas de l'Allemagne, que ce soit pour s'en réjouir ou le déplorer, notamment dans une perspective anti-communiste (voir Gavin Bowd, « La France et la Roumanie communiste », Paris : l'Harmattan, 2009).
[60] Il n'y a pas eu de débarquement allié à Bordeaux, mais des négociations compliquées avec la Résistance et la municipalité collaborationniste pour obtenir le départ des Allemands sans que ceux-ci détruisent le port ni la ville. Ce départ se réalise les 26 et 27 août. Un projet britannique de débarquement à Bordeaux avait été toutefois conçu en juin, mais il n'a pas eu de suite.
[61] Par l'armée du général de Lattre.
[62] Le commissariat de police du 6ème arrondissement avait l'information depuis le 23 août à 17 h 15 heures par un communiqué de la Préfecture de Police. Dupuy 1945 : 33, raconte qu'il a lu ce communiqué peu après aux personnes venues l'accoster à la sortie du bureau. Apparemment, André n'a donc appris la nouvelle que le lendemain, par la presse.
[63] Marie-Hélène était la fille cadette des Couteau, amie de Geneviève.
[64] Dupuy 1945 : 12 indique que, dès le 19 août, les drapeaux « font des apparitions timides derrière les rideaux de certaines fenêtres ».
[65] L'hôtel Crillon était occupé par des dignitaires nazis.
[66] Les « Tigres » sont des chars allemands.
[67] Des éléments avancés de la division Leclerc étaient entrés dans Paris par la porte d'Italie à 20 h 45, et se sont trouvés devant l'Hôtel de Ville vers 21 h 20, où le capitaine Dronne va saluer à l'hôtel de ville de Paris Georges Bidault, Président du Conseil National de la Résistance. On voit donc que les informations circulaient à toute vitesse à ce moment, notamment par la radio, malgré les difficultés d'approvisionnement en électricité. La Résistance avait repris l'antenne aux Allemands le 20 août.
[68] Dupuy 1945 : 36, note que, ce soir-là, « chaude nuit d'août (…), une obscurité totale règne que zèbrent de temps à autre des balles lumineuses jaillies des tours de Saint-Sulpice. »
[69] Cette sonnerie ne fut nullement spontanée, mais à l'initiative du secrétaire général à l'Information, demande relayée par la radio. Il fut demandé à tous les curés de Paris de faire sonner les cloches des églises à toute volée pour annoncer la libération de la capitale (à cette heure-là, à peine 15% du territoire parisien était libéré…). « Et les curés de la rive gauche de la Seine ont courageusement… attendu qu'un confrère ose en premier faire sonner les cloches dans la nuit noire qui commençait… Cela dura quelques minutes, puis soudain depuis la tour sud de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le puissant bourdon ‘Emmanuel’ (treize tonnes, son battant seul pèse 500 kg ; sa sonnerie était audible à près de cinq kilomètres à la ronde !…) a osé lancer dans la nuit parisienne sa joyeuse sonnerie en ‘fa dièse’ qui annonçait au peuple parisien de la rive gauche et de la banlieue Sud que Paris était enfin libéré !… Courageusement alors, les autres clochers de la rive gauche ont alors relayé la sonnerie du bourdon Emmanuel » (d'après http://deuxiemeguerremondia.forumactif.com/t6069-une-cloche-sonne-sonne).
[70] La description par Dupuy 1945 de ce moment est plus ample et plus lyrique (pp. 36-37) : « Tout à coup (il est exactement 22 h. 10) les cloches sonnent provoquant chez tous un tressaillement d'allégresse. D'instinct, les Parisiens devinent que nos chers alliés ont atteint la capitale. Alors, une clameur immense retentit dans la Cité : vivats, Marseillaises ardentes, chants patriotiques éclatent de toutes parts à l'intérieur des immeubles où chacun attendait, frémissant, l'exaltante nouvelle. Cloches de Saint-Sulpice qui, comme dans les nuits de Noël, avez fait monter vers le ciel un carillon libérateur, quelle émotion nous avons eue à vous entendre ! Vos tintements joyeux, en cette heure inoubliable, résonneront à jamais dans nos souvenirs et dans nos cœurs. »
[71] Je n'ai pas trouvé d'allusion à ce feu d'artifice
[72] Dupuy 1945 : 38 indique que « déjà, à la faveur de la nuit, drapeaux et guirlandes ont fleuri dans tous les immeubles. La rue Madame est pavoisée dans toute sa longueur et jusqu'aux plus hauts étages. »
[73] La sœur aînée de Marie-Hélène Couteau.
[74] Malgré le sentiment de délivrance, l'armée alliée, pour l'essentiel américaine, était aussi perçue comme une armée d'invasion. C'est pour atténuer ce sentiment que le commandement allié avait fini par autoriser un contingent français dans les troupes du débarquement, afin « d'exercer une heureuse influence sur [leurs] rapports avec la population française ». A la date de la libération de Paris, il était plus clair que le général de Gaulle allait pouvoir jouer un rôle politique qui garantisse l'indépendance nationale, et l'arrivée en tête symbolique de la division Leclerc marquait ce changement (Dansette 1994 : 111).
[75] C'est sans doute à ce moment que le caporal-chef Auguste Fenioux est tué rue de Seine ; il a été transporté à l'hôpital Laennec où il décède à 13 h 50 (cf. http://www.liberation-de-paris.gilles-primout.fr/eplaque6.htm). Les 25 et 26 août ont représenté le maximum d'activité de ces tireurs de la dernière chance, comme en témoigne la main-courante de la Préfecture de Police (enregistrement écrit de conversations téléphoniques) publiée par Suzanne Campaux : « La libération de Paris, 19-26 août 1944, récits de combattants et de témoins », Paris : Payot 1944 (cf. http://www.liberation-de-paris.gilles-primout.fr/etelephone.htm).
[76] Le 25 août à 1 h 30 du matin, la Préfecture avait ordonné de prévoir un dispositif d'évacuation dans un rayon de 300 mètres, et « d'envoyer des agents dans les immeubles pour dire aux gens de descendre dans les caves. » (Dupuy 1945 : 37). Il précise (p. 38) que « informés, les habitants du voisinage passent la nuit [du 24 au 25 août] dans les caves sans être certains d'y trouver un abri efficace contre le terrifiant danger ». Dansette 1994 : 304, sait que quelques habitants du quartier ont reçu des coups de téléphone au début de la soirée, mais il ignore d'où venait l'information. Geneviève, la fille d'André, indique dans un petit texte qui est son seul témoignage de l'époque, qu'ils ont été prévenus à 23h 30 : « Nous nous couchons à 11 heures. A 11 heures et demie on frappe à la porte. Monsieur Couteau vient nous avertir que la radio anglaise vient de recommander aux habitants proches du Sénat de descendre dans leurs caves à cause d'une attaque imminente. D'ailleurs les F.F.I. passent chez les concierges pour faire observer ce conseil. Nous descendons. Tout le monde est déjà en bas. Guy et moi jouons au bridge avec Monique et Marie-Hélène à moitié endormies. Enfin ne voyant rien de pire que les boum (sic) habituels, cependant plus forts, car il s'y mêle le canon, nous remontons à 2 h du matin. » Cet épisode n'a pas été repris par André.
[77] Dupuy 1945 : 25 fait état de cette information dès le 22 août : au Palais du Sénat « se trouvent 300 hommes – des S.S. dit-on – décidés, en cas d'attaque de notre part, à se défendre jusqu'au dernier et même à faire sauter l'édifice (ils nous l'ont fait savoir). Dix tonnes de cheddite sont entassées dans des trous à dix mètres de profondeur creusés derrière le musée. La pensée d'une telle explosion remplit de terreur tout le voisinage. » Le 23 au soir, au commissariat, « de plus en plus angoissante se pose la question de l'évacuation des immeubles avoisinants en raison de l'explosion possible des 10 tonnes de cheddite – de quoi faire sauter tout un quartier. » (ibid. p. 36).
[78] Cette mention n'est pas très claire : on croit comprendre que les habitants ont reçu une nouvelle consigne de descendre dans les caves après le déjeuner, pour un assaut supposé se dérouler vers 2 heures ? Ou faut-il penser que certains sont restés dans la cave depuis la veille au soir ?
[79] Cette information, diffusée par des voitures à haut-parleur de la Préfecture de Police et des hommes de la défense passive, était destinée à faire pression sur les Allemands du Sénat pendant la négociation de leur reddition (Dansette 1994 : 331). Cette menace était d'autant plus crédible pour les Allemands que la défense anti-aérienne du Sénat avait été démontée le 13 août, lors du départ de la Luftwaffe (Dansette 1994 : 118).
[80] Dupuy 1945 : 41, indique que les Allemands se rendirent à 18 h 10.
[81] Voici comment Dupuy 1945 : 42-43 raconte la scène (il n'en a pas été le témoin oculaire, et en tient les détails d'un ami qui était adjudant-chef de la Garde Républicaine de la caserne Tournon) : « Quelques minutes après [la reddition], l'infâme croix gammée était arrachée du fronton de l'édifice et le drapeau tricolore hissé au sommet du dôme par trois employés du Sénat, aux applaudissements frénétiques d'une foule enthousiaste accourue rue de Tournon. Le drapeau allemand, qui flottait à la porte du Palais depuis le 6 novembre 1940, est enlevé par des soldats français et jeté à terre. M. Desmaisons, Chef de Division au Sénat, ramasse l'emblème détesté et le remet au capitaine Migette de la Garde Républicaine qui le fait porter à la caserne Tournon par le lieutenant Guide. »
[82] De fait, la plupart des prisonniers « passeront la nuit à la belle étoile, couchés ou assis par terre, sous la surveillance de gardes républicains ou d'agents de police », dans la cour du Sénat (Dupuy 1945 : 43).
[83] Dupuy 1945 : 43, qui ne quitte pas son quartier, indique que « à minuit, l'on danse encore au son de l'accordéon, place Saint-Sulpice ». Il n'évoque aucun combat ni tirs isolés.
[84] Ils feront le tour du jardin du Luxembourg, dans lequel se trouve le palais du Sénat. La description du dispositif de blockhaus prenant en enfilade toutes les rues y menant est intéressante.
[85] Ce blockhaus était connu de Dupuy au moins dès le 24 août, car il en parle à cette date (p. 38), sans d'ailleurs avoir l'air de le découvrir à ce moment, ce qui indique qu'il devait le connaître depuis bien plus longtemps.
[86] Clotilde Voisin était une amie de Geneviève, qui habitait rue Guynemer.
[87] Ce type d'établissement est en voie de disparition, mais celui-ci existe toujours (http://www.pension-marronniers.com/).
[88] Celle-ci le conserve toujours. André ne dit pas qu'il a ramassé aussi des éclats d'obus et une balle, que Geneviève a également gardés.
[89] Située 2, rue de l'Observatoire, cette école formait les cadres de l'administration coloniale. Guy, le fils d'André, y fera ses études peu après la guerre.
[90] Au 63 du boulevard Saint-Michel, c'était un café estudiantin célèbre.
[91] Cet épisode a donné lieu à l'anecdote dite « de la cinquième colonne », par exemple sur un site d'histoire de Paris (http://www.parislenezenlair.fr/histoire-de-paris/anecdotes/136-anecdotes-8e-arrondissement.html?showall=1&limitstart= ) : « Quelques coups de feu éclatent encore, et ce jour, c'est la panique qui gagne les Parisiens massés sur la place. Quelques blessés et tués jonchent le sol. Un char de la 2ème DB du général Leclerc, commandé par un lieutenant FFI, est en position, pour protéger l'arrivée du général de Gaulle, attendu impatiemment par la foule. Les coups de feu partent de l'hôtel Crillon. L'un des tankistes crie alors : ‘La cinquième colonne !’. Cette expression désignait, à l'époque, des traîtres ou des espions agissant pour le compte de l'ennemi, en sous-main. Mais le tireur, dans l'habitacle du char, interpréta différemment ce qui n'était qu'un cri d'alarme. Il mit en joue… la cinquième colonne du Crillon ! Et c'est pour ça que, encore de nos jours, la cinquième colonne du Crillon, reconstruite dans une pierre plus grise que ses consœurs, affirme nettement sa différence, de couleur. »
[92] Ces scènes illustrent tout-à-fait la notation générale de Dansette 1994 : 362 : « La fusillade a commencé en divers points du parcours [du général de Gaulle] et la foule a invariablement offert à l'observateur de sang-froid le même spectacle d'un affolement fertile en scènes risibles ou tragiques. (…) Ce sont partout d'extraordinaires amoncellements de corps avec des jupes de femmes remontées au-dessus de la taille et des sacs pressés contre les visages pour les protéger des balles. » Il semble que la majorité des coups de feu aient été tirés par des F.F.I. ou des soldats français, croyant tous, dans la panique, avoir affaire à des francs-tireurs. La thèse d'un complot contre le général de Gaulle semble en tous cas écartée, car, comme le dit André, les tirs ont commencé bien après son passage (voir l'analyse de Dansette 1994 : 366).
[93] Cette expression désuète était banale, elle est aussi employée par Dupuy 1945 : 26, qui intitule un de ses chapitres : « Ils sont jeunes ; mais ils sont crânes », en parlant des gardiens de la paix du 6ème arrondissement. Ils nous en reste les termes « crâner » et « crâneur », qui sont devenus péjoratifs.
[94] Au coin de la rue Garancière et de la rue Saint-Sulpice, cette maison éditait notamment la célèbre collection « Signes de piste ». Ironie de l’Histoire, Alsatia a été rachetée en 2005 par un groupe de presse allemand, Bertelsmann.
[95] L'Hôtel de la Monnaie de Paris se situe 11, quai de Conti. Dupuy 1945 : 53 fait allusion à ces épisodes : « Cependant, sur ce général [de Gaulle] que la France accueille aujourd'hui comme son chef incontesté et sur cette foule heureuse accourue pour l'acclamer, des criminels (miliciens ou Allemands perchés sur les toits), se donnant pour mission de ‘refroidir l'enthousiasme’, se mettent à tirer des rafales de mitrailleuse. Des hommes, des femmes, des enfants tombent. Le sang coule. Sur toutes les voies suivies par le cortège, le crépitement des fusillades se mêle aux acclamations de la foule. Spectacle unique et farouchement beau… »
[96] Vers 23 h, la 3ème flotte aérienne allemande bombarde le nord et l'est de Paris faisant 189 morts, 890 blessés, détruisant 392 immeubles et en endommageant 395 autres.
[97] Paul Chack (1876-1945) était un officier et un écrivain français. Il fut à la fin des années 1930 un partisan du fascisme et se signala pour son engagement collaborationniste. Il fut condamné à mort à la Libération et fut, avec Robert Brasillach, l'un des quelques intellectuels français exécutés pour collaboration.
[98] Comédien et dramaturge français (1885-1957), il fut arrêté par un groupe de résistants agissant de leur propre initiative. Il resta soixante jours en prison, et sera libéré avec un non-lieu. On lui reprochait essentiellement de ne pas avoir cessé son activité créatrice et médiatique pendant l'Occupation.
[99] Le pavillon de Marsan est l'un des deux pavillons du palais des Tuileries qui subsistent après l'incendie de 1871, toutefois très largement reconstruit en 1874 (celui du nord, le long de la rue de Rivoli).
[100] Il s'agit de la statue équestre de Jeanne d'Arc place des Pyramides. L'hôtel Regina est un grand hôtel situé sur cette même place, qui avait été réquisitionné par les Allemands (comme le Crillon voisin).
[101] Gretchen est le diminutif allemand du prénom Greta. Ce sobriquet a été utilisé par les Français pour désigner toutes les femmes allemandes et surtout les auxiliaires féminines de la Wehrmacht, aussi appelées « souris grises ».
[102] Jacques Doriot (1898-1945) était un homme politique et un journaliste, communiste puis fasciste. Il fut l'une des figures de proue du collaborationnisme : il fonda le Parti Populaire Français, qui fut durant l'occupation allemande l'un des deux principaux partis français de la collaboration. Il s'était exilé en Allemagne après le débarquement de Normandie.
[103] Il s'agit d'établissements situés boulevard des Italiens, qu'un travail plus poussé permettrait sans doute d'identifier.